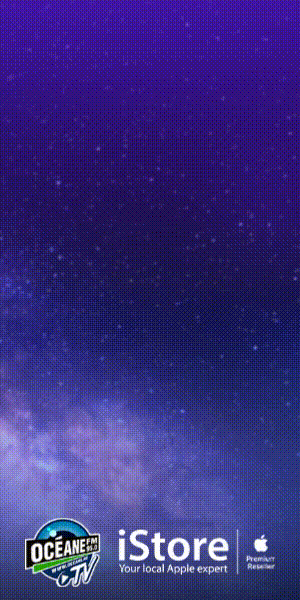La Dépêche de Nouméa a reçu et souhaite diffuser le témoignage de Maïa, Calédonienne qui a traversé un cancer du sein et s’en est relevée. Nous le publions non pour rechercher l’émotion facile, mais pour briser un silence qui retarde encore trop de dépistages. Ce récit dit la vérité des trajets, des peurs, des traitements, et des solidarités qui soutiennent quand tout vacille. Lire Maïa, c’est mesurer ce que peut une communauté quand elle regarde la maladie en face. Son histoire n’est pas un cas isolé : c’est un appel à la responsabilité, individuelle et collective.
« Voici mon histoire. Je m’appelle Maïa, j’ai 41 ans, je suis maman de deux garçons et je vis à Poindimié. En juillet, il y a deux ans, sous la douche, j’ai senti une petite boule au-dessus du sein gauche. Pas de douleur, rien d’alarmant en apparence. J’ai d’abord voulu oublier. Chez nous, on n’en parle pas facilement. Puis j’ai pensé à mes sœurs, à mes enfants. J’ai pris rendez-vous au dispensaire, puis on m’a orientée vers une mammographie à Nouméa.
Le jour des examens, j’ai eu peur comme jamais. Échographie, biopsie. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné : “carcinome canalaire infiltrant, pris assez tôt”. J’ai entendu “cancer” et tout s’est brouillé. J’ai pleuré sur le parking, puis j’ai respiré. L’oncologue m’a parlé clairement du plan : tumorectomie, puis chimiothérapie et radiothérapie. “On a des armes, Maïa. Vous n’êtes pas seule.” Cette phrase m’a tenue debout.
L’organisation a été un combat à part entière. De Poindimié à Nouméa, c’est des heures de route, des nuits chez une cousine à Dumbéa, des congés posés par mon mari, des gardes pour les enfants. La Ligue contre le cancer m’a aidée pour la logistique et des conseils pratiques : une trousse avec une crème pour la peau, un carnet pour noter les questions, et surtout une oreille. J’ai découvert la solidarité des inconnus : un covoiturage improvisé, un sourire à l’accueil, une infirmière qui s’assoit cinq minutes de plus quand on vacille.
La chirurgie s’est bien passée. Le plus dur, pour moi, ça a été la chimio. La fatigue lourde, les nausées qui arrivent sans prévenir, le goût métallique dans la bouche, les cheveux qui tombent. Le jour où j’ai décidé de me raser la tête, mes sœurs étaient là. On a fait de ce moment quelque chose de doux : de la musique, des rires, des foulards choisis ensemble au marché. Je me regardais dans le miroir en cherchant “où je suis passée”. Et puis j’ai découvert d’autres forces : mes yeux qui tenaient bon, mes mains qui cuisinaient encore pour mes garçons, mes pieds qui me portaient jusqu’à la mer.
La radiothérapie m’a épuisée d’une autre manière : c’est court, mais c’est tous les jours, et le corps devient peau vive. J’ai appris à m’écouter. J’ai accepté de dire “non” au travail, “j’ai besoin d’aide” à la maison. Mes voisins sont venus avec des barquettes de bougna, des mangues, des gestes simples qui nous ont nourris plus que la nourriture. Le dimanche, on allait au bord du lagon. Je m’asseyais à l’ombre et je regardais les garçons plonger. Je me promettais de replonger avec eux.
J’ai rejoint un petit groupe de femmes qui passaient par les mêmes étapes. On se retrouvait après les séances, on parlait du concret : hydrater la peau, choisir un soutien-gorge post-opératoire, apprivoiser la repousse des cheveux, expliquer aux enfants avec des mots vrais. Dans ce groupe, j’ai appris que la honte ne guérit rien, que le silence fatigue, et que dire “j’ai peur” ouvre la porte à “on va faire face”. Pendant Octobre Rose, j’ai attaché le ruban à mon sac. Pas pour faire joli. Pour me rappeler que mon corps n’était pas un ennemi, qu’il se battait avec moi.
Les derniers contrôles ont dit “rémission”. Je n’ai pas sauté de joie tout de suite. La peur s’en va lentement. J’ai fêté ça à ma façon : j’ai nagé de la plage jusqu’au rocher avec mes fils. L’eau était fraîche, la lumière du matin faisait scintiller le lagon. Je me suis sentie vivante comme jamais. Aujourd’hui, je suis suivie régulièrement. J’ai repris le travail à mon rythme. Je cuisine plus léger, je marche le soir, je ris souvent, et j’écoute mes alertes intérieures.
Si je raconte tout ça, c’est pour celle qui lit ces lignes dans le doute. Oui, on a peur. Oui, les trajets sont longs, les rendez-vous prennent du temps, les mots font mal. Mais plus on s’y prend tôt, plus on se donne de chances. N’attends pas un symptôme. Parle-en à une amie, à ta mère, à ton conjoint, à ton médecin. Demande de l’aide pour la route, pour garder les enfants, pour t’accompagner. Mets les examens dans ton agenda comme on met une date importante : pour toi.
Je ne suis pas devenue une héroïne. Je suis Maïa, une Calédonienne qui a traversé la tempête et qui continue d’avancer, un pas après l’autre. Si tu as la boule au ventre, sache que la tienne n’est pas seule : il y a des soignants, des associations, des voisines, des familles entières qui savent se mobiliser. Le ruban rose n’est pas une mode. Pour moi, c’est un rappel : ma vie compte, ton corps mérite qu’on s’en occupe, et ensemble on peut tenir bon.
Petit mot de prudence : mon parcours est le mien. Chaque situation est différente. Parle toujours de tes symptômes, questions et choix de traitement avec un professionnel de santé. »