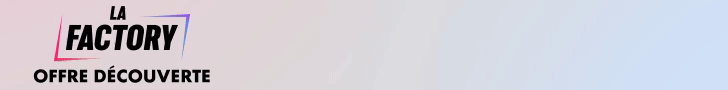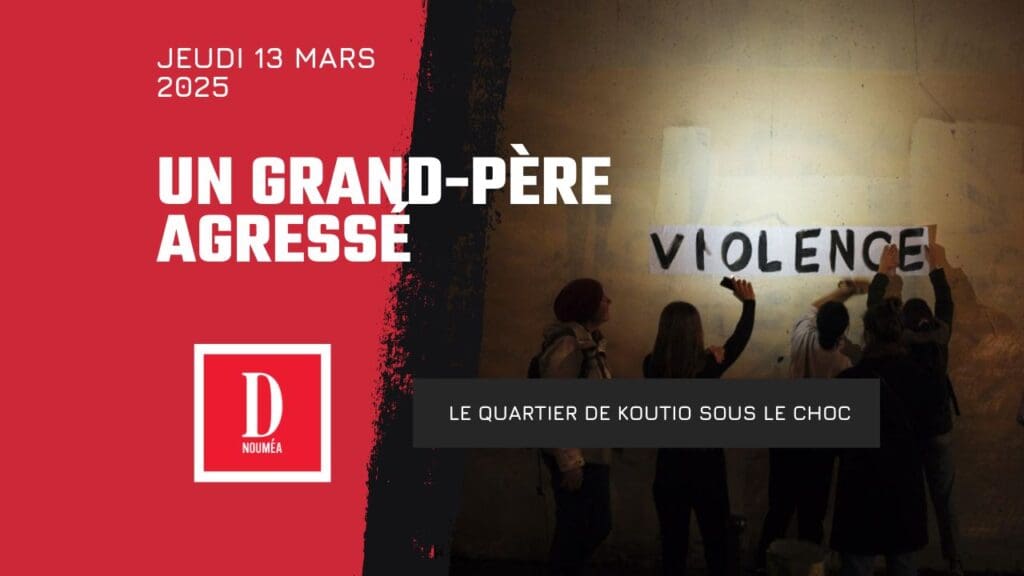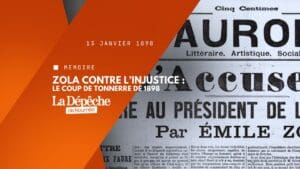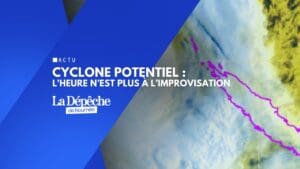Depuis plus d’une décennie en Nouvelle-Calédonie, la Croix-Rouge porte un programme audacieux : Alerte, Anticipons les risques tous ensemble. Plutôt que de viser directement les adultes, ce projet mise sur les enfants, à l’école ou lors d’événements, pour semer les graines d’une culture du risque dans les foyers et les communautés.
Pourquoi cibler les enfants : une stratégie pas si innocente
Contrairement à une approche top-down classique, Alerte s’adresse d’abord aux élèves de CM2, publics particulièrement réceptifs à cet âge. À travers cette démarche, les enfants deviennent des relais de messages dans leur entourage familial. L’idée n’est pas seulement de leur faire comprendre ce qu’est un cyclone ou un séisme, mais de les transformer en ambassadeurs de la sécurité au quotidien.
Ce choix est pertinent : en Nouvelle-Calédonie, certains risques sont bien connus cyclones, inondations mais d’autres restent abstraits pour la population, comme les tsunamis ou les mouvements de terrain. Ce sont précisément ces risques « invisibles » que le projet cherche à faire émerger à travers un langage accessible et ludique.
Deux axes d’intervention : risques naturels et premiers secours
Lorsque la Croix-Rouge déploie Alerte dans une école, elle propose deux ateliers complémentaires :
- Risques naturels : les enfants découvrent les phénomènes (inondations, cyclones, tremblements de terre, feux de forêt, glissements de terrain, tsunamis) et apprennent à les identifier et à anticiper certains.
- Premiers secours : une initiation adaptée à leur âge (10-11 ans), avec des saynètes, simulations et supports pédagogiques (jeux, vidéos, maquettes), pour savoir comment alerter ou réagir.
Ces ateliers sont animés par des bénévoles formés en interne par la Croix-Rouge, et mobilisent des outils interactifs y compris des casques de réalité virtuelle pour prolonger l’expérience hors du cadre scolaire, notamment lors d’événements grand public comme la Fête de la Science.
Fête de la Science : étendre l’impact à toute la population
Pendant la Fête de la Science, Alerte ne reste pas cantonné aux classes : il s’installe dans l’espace public, avec exposition, démonstrations, réalité virtuelle… L’objectif : dialoguer avec les familles, inviter les enfants à raconter ce qu’ils ont appris, et créer une dynamique collective. Grâce à ce dispositif, les messages dépassent les murs de l’école pour rejoindre les foyers.
Ce temps fort permet aussi d’attirer l’attention des adultes curieux, souvent peu familiers avec certains risques. Pour un projet centré sur les enfants, c’est une belle occasion de faire rayonner la prévention au-delà du cercle scolaire.
L’évolution nécessaire : mesurer l’impact, diversifier les niveaux, rayonner au-delà
Sans remise en cause de la méthode, plusieurs défis restent à relever pour faire passer Alerte à la vitesse supérieure :
- Mesurer l’impact réel : jusqu’à présent, on évalue les connaissances immédiatement après les ateliers. Mais qu’en est-il des comportements à moyen terme ?
- Aller au collège (voire au lycée) : construire un continuum pédagogique pour éviter l’effet « one shot ».
- Intégrer le programme scolaire : collaborer avec les autorités de l’Éducation pour que les modules Alerte soient reconnus comme séquences officielles.
- S’étendre dans le Pacifique : dans d’autres territoires insulaires, les vulnérabilités aux catastrophes naturelles sont similaires. Étendre le projet à la région peut renforcer sa cohérence.
- Évolution pédagogique : ajouter des thématiques comme le changement climatique, la résilience, ou des scénarios plus complexes.
Un exemple concret : en période de feux de brousse, Alerte renforce ses messages citoyens, limiter les départs de feu, connaître les numéros d’urgence, agir correctement, pour faire de la prévention active plutôt que de la réaction seule.
Semer la résilience dès l’enfance
Le projet Alerte s’impose comme un pari à long terme, une stratégie qui mise moins sur l’effort direct auprès des adultes que sur le pouvoir pédagogique des enfants. En les formant aux risques et aux gestes qui sauvent, on cherche à bâtir une culture durable de la sécurité dans les familles et les communautés.
Mais pour que cette graine porte ses fruits, il faudra consolider les fondations : mesurer l’impact, élargir les publics, structurer les liens avec l’Éducation, et franchir les océans pour partager l’expérience dans le Pacifique.