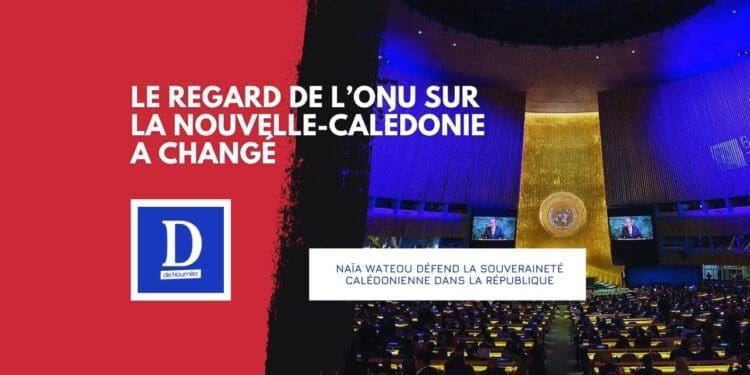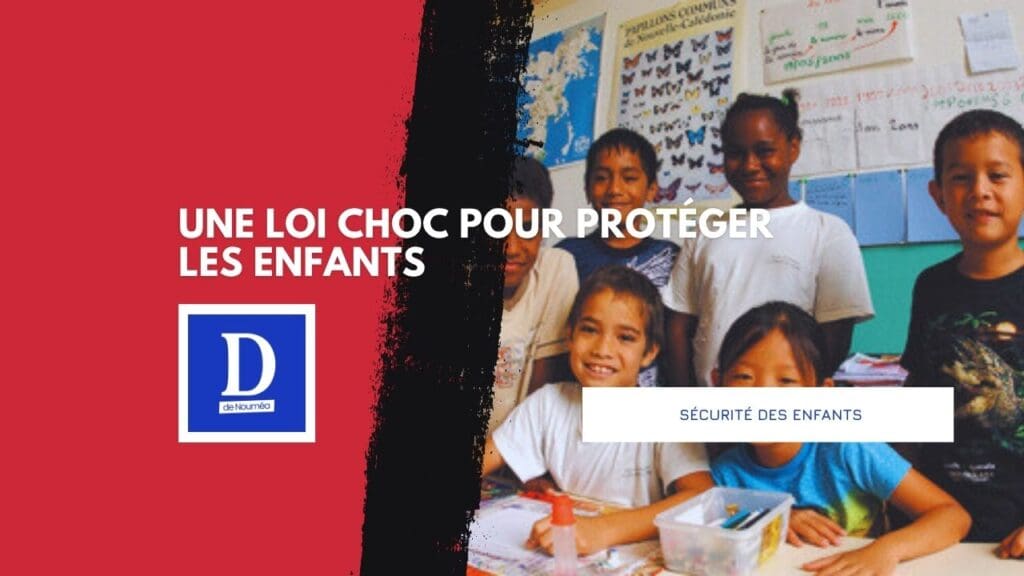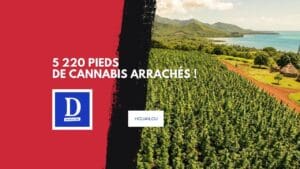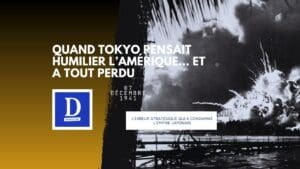À New York, Naïa Wateou plaide pour la stabilité calédonienne, dénonce les ingérences et défend Bougival comme une voie d’autonomie au sein de la République.
Une voix calédonienne à la tribune internationale
De retour de New York, Naïa Wateou, élue de la province Sud, a livré un message clair devant la quatrième commission de décolonisation de l’ONU. Dans une ambiance diplomatique tendue, elle a rappelé que la volonté des Calédoniens avait été exprimée à trois reprises : celle de rester dans la République française. Son intervention, menée aux côtés de Marie-Laure Ukeiwé, visait à rétablir une réalité souvent déformée par certains discours indépendantistes ou extérieurs.
L’objectif, selon elle, était double : affirmer la légitimité du choix populaire et alerter sur les influences étrangères qui viennent, selon ses mots, “polluer le débat local”. Ces propos faisaient référence à la présence de pétitionnaires sans lien direct avec le territoire, parfois issus de pays tiers, dont les prises de position trahissent des agendas géopolitiques éloignés des préoccupations calédoniennes.
Au sein de cette commission, la représentante sudiste a également mis en avant le processus en cours autour de l’accord de Bougival, présenté comme une « quatrième voie » conforme à la charte de décolonisation des Nations unies. Un modèle, selon elle, d’autonomie élargie dans le cadre républicain, permettant à la Nouvelle-Calédonie de conjuguer identité propre et stabilité politique.
Le rappel des faits : émeutes, responsabilités et vérité
L’élue n’a pas esquivé les sujets sensibles. Elle a tenu à revenir sur les émeutes du 13 mai 2024, pointant la responsabilité du collectif CCAT, qu’elle accuse d’avoir orchestré la contestation ayant dégénéré. Cette prise de position visait à rétablir les faits devant la communauté internationale, dans un contexte où certains groupes présentent encore la crise calédonienne comme une insurrection populaire légitime.
Cette séquence a permis à Naïa Wateou d’insister sur la nécessité d’assumer les conséquences locales, notamment pour les institutions de la province Sud, confrontées à la reconstruction économique et sociale. L’intervention visait également à corriger des récits biaisés, tels que les accusations de répression policière ou d’“apartheid administratif” évoquées par certains pétitionnaires pro-indépendance.
Ce positionnement s’inscrit dans une stratégie plus large : rétablir la crédibilité calédonienne à l’international. À ses yeux, il s’agit d’un devoir de clarté envers les Nations unies comme envers les citoyens. La bataille de l’opinion ne se joue plus uniquement sur le terrain politique, mais désormais aussi sur celui de la diplomatie narrative.
Bougival : une quatrième voie entre indépendance et dépendance
L’un des points majeurs de l’intervention à New York portait sur l’accord de Bougival, que Naïa Wateou défend comme une “solution médiane” entre indépendance et statu quo. En rappelant que la Charte de l’ONU offre quatre options de décolonisation, indépendance, association, État librement consenti et autonomie interne, elle place la Nouvelle-Calédonie dans la dernière catégorie, celle de la responsabilité partagée au sein d’un État.
Cette vision se veut une alternative pragmatique : plus d’autonomie institutionnelle, sans rupture avec la France. Elle s’appuie sur une relecture du processus engagé depuis les accords de Matignon et de Nouméa, interprétés comme des étapes successives d’un chemin politique plutôt que comme des fins en soi.
En défendant Bougival, N. Wateou cherche à rompre avec la logique de blocage. Son propos rejoint celui de plusieurs délégations du Pacifique notamment Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, pour la première fois, ont soutenu la poursuite du dialogue plutôt qu’une revendication d’indépendance immédiate. Ce changement de ton est perçu comme un tournant diplomatique majeur.
Une ONU plus réceptive au discours calédonien
Derrière les discours, un constat s’impose : le regard de l’ONU sur la Nouvelle-Calédonie a changé. Les dernières sessions de la commission de décolonisation ont salué le caractère exemplaire du processus français, sans remettre en cause la validité du troisième référendum de 2021.
Ce basculement tient en partie à un travail de fond mené depuis plusieurs années : rencontres bilatérales, entretiens informels, échanges avec les délégations du Pacifique et d’Asie. Les représentantes calédoniennes, dont N. Wateou et ML. Ukeiwé, ont su entretenir un dialogue constant, renforçant ainsi la compréhension du dossier par les membres de la C24.
Cette stratégie diplomatique, patiente et ciblée, a aussi pour but de contrer les campagnes d’ingérence, notamment celles émanant d’acteurs extérieurs au Pacifique. Dans un contexte géopolitique marqué par la rivalité sino-occidentale et l’activisme d’États tiers comme l’Azerbaïdjan, la Nouvelle-Calédonie apparaît désormais comme un point d’équilibre stratégique.
Un engagement durable dans les instances internationales
L’intervention à New York n’est qu’une étape. Naïa Wateou entend poursuivre le travail engagé au sein de la Commission C24, dont la prochaine session est prévue en mai. L’objectif : ancrer durablement la parole calédonienne dans les enceintes internationales et consolider la reconnaissance du processus français de décolonisation.
Selon elle, les indépendantistes auraient désormais “lâché la main” sur l’ONU, préférant se tourner vers d’autres forums, comme celui des peuples autochtones à Genève. Une évolution qui, pour les partisans du maintien dans la République, confirmerait la perte d’influence des discours séparatistes au sein des Nations unies.
Pour la représentante de la province Sud, il s’agit désormais d’une course contre le temps : reconstruire le pays après la crise, consolider le dialogue politique, et défendre, sur la scène internationale, une Calédonie stable, autonome et pleinement inscrite dans la République.
La séquence new-yorkaise aura permis à Naïa Wateou d’installer une ligne claire et cohérente : défendre la souveraineté calédonienne dans la République, dénoncer les manipulations extérieures et promouvoir un modèle d’autonomie concertée. À l’heure où les alliances du Pacifique se redessinent, cette voix, posée mais déterminée, veut rappeler que la décolonisation ne se mesure pas en slogans, mais en responsabilité et en vérité.