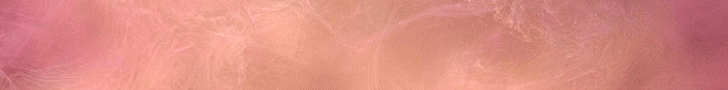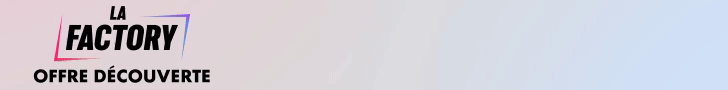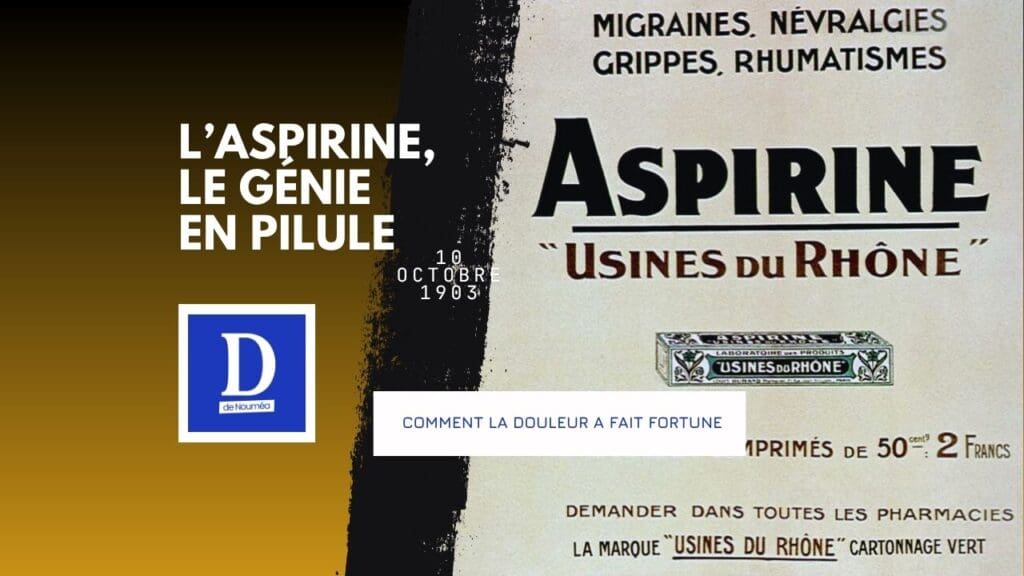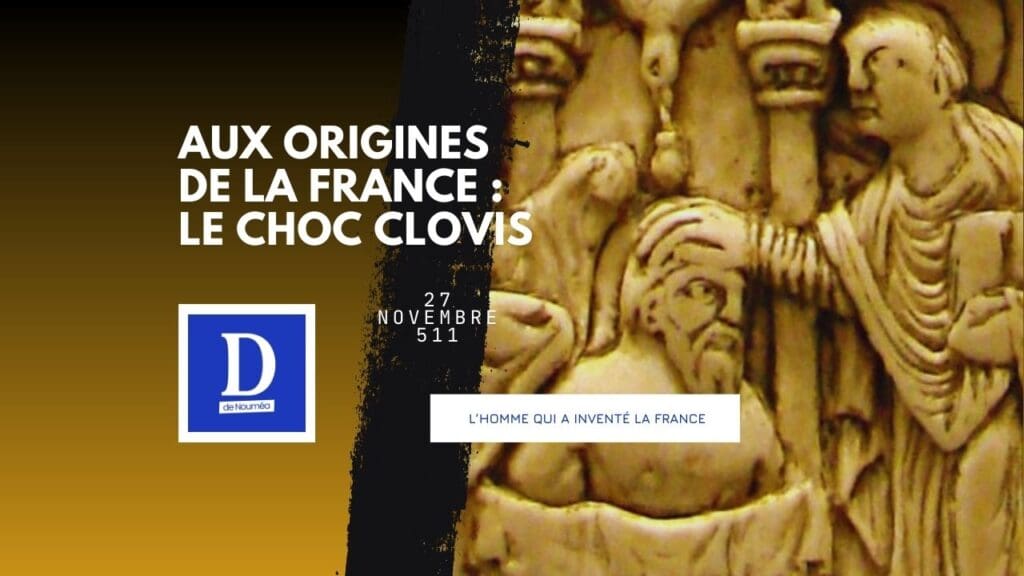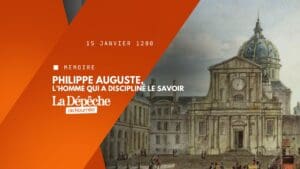Marie-Antoinette : la reine martyre de la France décapitée. Elle n’était pas parfaite, mais elle incarnait la France. En la guillotinant, les révolutionnaires ont voulu tuer plus qu’une reine : ils ont voulu effacer la mémoire du royaume.
Marie-Antoinette, victime expiatoire de la Terreur
Le 16 octobre 1793, la France décapitait sa dernière reine, à trente-sept ans. Dix mois après Louis XVI, Marie-Antoinette payait le prix d’une Révolution devenue folle, où la raison s’était noyée dans le sang. Le procès expéditif, tenu en deux jours, n’était pas un acte de justice, mais une vengeance politique, un symbole à abattre.
La « veuve Capet » fut jugée par un tribunal révolutionnaire décidé à frapper les esprits. Accusée sans preuve de trahison, de complot et même d’inceste, elle fut livrée à la haine publique. Face aux insultes et aux calomnies, elle opposa le silence et la dignité. Son ultime phrase, adressée à ses juges — « J’en appelle à toutes les mères » — resta dans l’Histoire comme le cri d’une femme broyée par la folie des hommes.
Dans ce Paris terrorisé par Robespierre et les sans-culottes, la reine devint le bouc émissaire idéal. Il fallait un visage à haïr, une victime à sacrifier. Marie-Antoinette, symbole vivant d’une monarchie déchue, incarnait tout ce que la République montagnarde voulait effacer : la noblesse, la grâce, la foi, la civilisation française.
Une femme de pouvoir devenue l’ennemie du peuple
Née à Vienne en 1755, Marie-Antoinette d’Autriche arrive à la cour de France à quatorze ans. Mariée au futur Louis XVI, elle devient reine en 1774, dans un royaume déjà fragilisé par la dette et les querelles de pouvoir. Sa jeunesse et son caractère libre lui valent rapidement la haine d’une partie de la cour et d’une opinion abreuvée de pamphlets orduriers.
Son surnom d’« Autrichienne » résonne comme une insulte politique. Elle incarne la femme étrangère, coupable de tous les maux : celle que l’on accuse de frivolité, d’orgueil, de trahison. Mais derrière les rumeurs se dessine une autre réalité : celle d’une reine courageuse, refusant la fuite et soutenant son mari jusqu’à la fin.
Quand Versailles tombe, elle comprend que la France bascule dans la violence. Enfermée, séparée de ses enfants, insultée par la foule, elle garde la tête haute. Au moment de son procès, elle affronte la mort sans trembler, refusant de demander grâce. Sa foi catholique et son éducation royale la tiennent droite face au couperet. Elle meurt debout, en reine.
La décapitation d’un ordre, pas seulement d’une femme
Le 16 octobre 1793, place de la Révolution — aujourd’hui place de la Concorde —, le couperet s’abat sous les cris de la foule. Mais ce jour-là, c’est bien plus qu’une tête qui tombe : c’est la France monarchique, millénaire, qui s’effondre sous la Terreur. En assassinant la reine, les révolutionnaires détruisent un héritage spirituel et culturel que la République ne remplacera jamais tout à fait.
Car Marie-Antoinette n’était pas seulement une femme : elle représentait un idéal, celui d’une France élégante, hiérarchisée, croyante et stable. Son procès fut le symbole d’une idéologie devenue machine à tuer, où l’égalité se confondait avec la haine et la liberté avec la vengeance.
La reine meurt en prière, les yeux vers le ciel, pendant que la foule hurle. Quelques décennies plus tard, ses restes sont transférés à Saint-Denis, auprès de Louis XVI : la réconciliation posthume d’un couple martyr, sacrifié sur l’autel de la Révolution.
Marie-Antoinette n’a pas fui : elle a affronté. Elle fut calomniée, trahie, humiliée, mais jamais soumise. En la condamnant, la Révolution a voulu décapiter la royauté ; elle a surtout donné naissance à un mythe — celui d’une reine martyre, symbole de la France éternelle face à la barbarie idéologique.
Son visage, figé dans la dignité, reste celui d’une femme injustement sacrifiée mais victorieuse dans la mémoire. Car les révolutions passent, mais les reines demeurent dans l’Histoire.