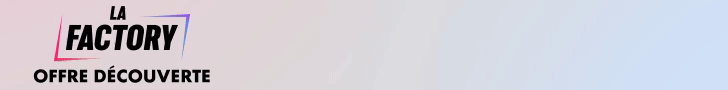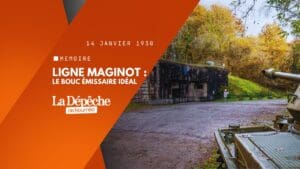La France conserve la main sur la Nouvelle-Calédonie. Mais un équilibre délicat se dessine entre souveraineté nationale et autonomie locale.
Une architecture constitutionnelle inédite, mais sous contrôle de Paris
C’est un texte historique que le Conseil d’État a examiné le 1er octobre 2025. Dans un avis dense et prudent, la haute juridiction valide le projet de loi constitutionnelle créant “l’État de la Nouvelle-Calédonie”, traduction juridique de l’accord de Bougival, signé en juillet et publié en septembre.
Le but : inscrire dans la Constitution une organisation institutionnelle “sui generis”, spécifique à la Nouvelle-Calédonie, tout en la maintenant au sein de la République française.
Le Conseil d’État rappelle que ce projet s’inscrit dans la continuité de l’accord de Nouméa (1998) et des accords de Matignon-Oudinot (1988), mais marque une nouvelle étape du processus d’émancipation sans rupture avec la France.
Il ne s’agit donc pas d’une indépendance déguisée, mais d’une forme d’autonomie constitutionnelle, encadrée, contrôlée et garantie par le droit français.
Les sages de la rue de Montpensier soulignent que cette réforme vise avant tout à ramener la stabilité politique après les troubles de mai 2024 et à redéfinir un cadre durable pour l’avenir institutionnel du territoire. Une stabilisation « pérenne », selon les mots de l’accord, afin d’éviter que le territoire ne demeure dans un entre-deux juridico-politique menaçant la cohésion nationale.
Un “État calédonien” reconnu, mais intégré à la République
L’un des points majeurs du texte est la reconnaissance constitutionnelle de “l’État de la Nouvelle-Calédonie”. Derrière cette appellation symbolique, aucune rupture d’unité nationale, mais une architecture institutionnelle inédite : une assemblée délibérante, une “Loi fondamentale” locale, et la possibilité d’une nationalité calédonienne, toujours adossée à la nationalité française.
Le Conseil d’État insiste sur ce point : toute personne de nationalité calédonienne restera citoyen français de plein droit. Autrement dit, la double appartenance prolonge le républicain, non une concurrence de souverainetés.
La France demeure l’unique puissance souveraine, notamment pour la défense, la justice, la monnaie et l’ordre public.
Les compétences dites “régaliennes” ne pourront être transférées qu’après approbation par référendum local, et sous le contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel.
Cette clause, saluée par les juristes, constitue une garantie ferme contre tout glissement séparatiste.
Le texte encadre strictement la capacité d’auto-organisation du territoire : la future “Loi fondamentale” calédonienne devra respecter les principes constitutionnels français, les accords internationaux et les orientations de l’accord de Bougival.
Ainsi, si la Nouvelle-Calédonie gagne en marge d’action interne, elle demeure sous l’autorité du droit français et du contrôle du Conseil constitutionnel.
Une manière de concilier reconnaissance identitaire et cohérence nationale — l’équilibre entre singularité et unité.
Une autonomie organisée, mais une République réaffirmée
Le Conseil d’État souligne que cette réforme ne crée pas un État étranger, mais une entité interne à la République, régie par un statut constitutionnel particulier. La terminologie d’“État” n’a pas de portée souveraine : elle relève d’un choix politique symbolique, non d’une indépendance de fait.
Le texte consacre le maintien du droit français, de la justice républicaine et du contrôle de légalité sur l’ensemble du territoire.
En validant cette architecture, le Conseil d’État réaffirme une vérité essentielle : la France reste souveraine sur son territoire ultramarin. Les institutions calédoniennes disposeront de compétences accrues, mais dans le cadre d’un État unitaire décentralisé, non fédéral.
La “Loi fondamentale” calédonienne, bien qu’elle puisse fixer des “valeurs” ou un “code de la citoyenneté”, devra passer le filtre du Conseil constitutionnel avant publication.
La République garde donc le dernier mot sur les normes et les symboles.
Sur le plan électoral, le Conseil d’État confirme le maintien d’un corps électoral restreint pour la consultation prévue avant avril 2026, limitée aux populations historiquement établies.
Une restriction assumée, justifiée par le respect du processus historique de décolonisation négociée, déjà validée par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme.
Loin d’être une anomalie démocratique, cette mesure garantit la continuité juridique du processus né des accords de Nouméa.
Enfin, la haute juridiction acte que l’entrée en vigueur du nouveau statut dépendra de l’approbation populaire. Si les Calédoniens rejettent l’accord de Bougival, le cadre actuel — celui de 1998 — restera en vigueur.
Une clause de sécurité constitutionnelle, pour éviter tout vide institutionnel et préserver l’ordre républicain.
Au terme de 25 ans de transitions, de référendums et d’accords successifs, la France semble avoir trouvé un équilibre.
Oui à la reconnaissance calédonienne, mais non à la désunion nationale. L’État calédonien existera, mais au sein de la République française, sous la garde du droit et de la Constitution.
Paris conserve la main, tout en tendant la sienne à la Nouvelle-Calédonie.
L’avis du Conseil d’État trace donc une ligne claire : autonomie ne signifie pas souveraineté, et le pluralisme institutionnel ne doit jamais contredire l’unité nationale.
Une vision de la France à la fois ferme et inclusive, où la diversité des territoires s’exprime sous une seule bannière : la République.