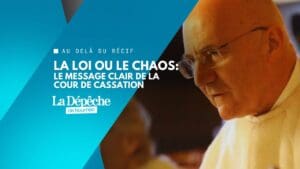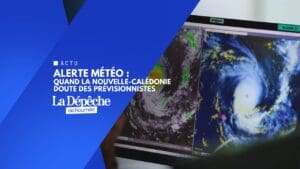Elles conquièrent la mairie, mais pas encore le pouvoir. La France a fait un pas historique vers la parité municipale, sans pour autant franchir le plafond de verre politique.
La parité municipale, un combat juridique de vingt ans
La parité politique ne s’est pas imposée naturellement : elle a été arrachée à coups de lois successives. Depuis la réforme constitutionnelle du 8 juillet 1999, la France a reconnu que la loi pouvait favoriser l’accès des femmes aux fonctions électives. Ce n’était pas un droit, mais une incitation républicaine.
Dès 2000, la loi sur la parité impose un équilibre dans les communes de plus de 3 500 habitants. Puis, en 2007, le principe s’affine : les listes doivent alterner strictement hommes et femmes, sous peine d’être invalidées. En 2013, la réforme descend le seuil à 1 000 habitants, bouleversant le paysage local : d’un coup, des milliers de conseils municipaux deviennent paritaires dans leur composition.
Les chiffres le prouvent : on compte 48,5 % de femmes conseillères municipales en 2020 dans les communes de plus de 1 000 habitants, contre seulement 37,6 % dans les plus petites. Un progrès, certes, mais à deux vitesses. Dans les intercommunalités, la part féminine plafonne encore à 35 %. Autrement dit : la parité s’affiche dans les chiffres, mais pas encore dans les faits.
2025 : la fin du “deux poids, deux mesures”
Le Parlement a tranché. Avec la loi du 21 mai 2025, la République applique désormais le scrutin de liste paritaire à toutes les communes, même les plus petites. Fini le scrutin majoritaire plurinominal, hérité du XIXe siècle, où les électeurs pouvaient composer leur bulletin librement, souvent au détriment des femmes.
Dès mars 2026, les 70 % de communes françaises de moins de 1 000 habitants devront présenter des listes alternées homme/femme, comme leurs grandes sœurs urbaines. C’est une révolution silencieuse pour les villages de France. Le rapport parlementaire l’a rappelé : sans contrainte, la parité ne viendra jamais d’elle-même.
Les effets se feront sentir jusque dans les intercommunalités. Car plus la structure est grande, plus les femmes y trouvent leur place. Mais dès qu’on approche de la présidence, le nombre chute brutalement. Le Haut Conseil à l’Égalité le confirme : 44,3 % de femmes parmi les adjoints, 33,5 % parmi les premiers adjoints, à peine 23,8 % de femmes maires dans les communes de plus de 100 000 habitants.
En clair, les femmes siègent de plus en plus, mais dirigent encore trop peu.
L’exemple calédonien : une lente conquête du terrain politique
En Nouvelle-Calédonie, territoire où la proximité du pouvoir local est essentielle, la parité avance aussi, mais avec prudence. Sur les 33 communes du territoire, seules 8 sont dirigées par des femmes. Un chiffre modeste, mais révélateur d’un mouvement de fond : les électrices et les candidates s’imposent désormais dans un univers politique longtemps réservé aux hommes.
Les communes calédoniennes de moins de 1 000 habitants seront directement concernées par la loi de 2025. L’enjeu est double : non seulement accroître la représentation féminine, mais aussi renforcer la légitimité démocratique des petites communes, souvent verrouillées par des logiques claniques ou familiales.
À l’horizon 2026, la parité municipale intégrale pourrait transformer en profondeur la vie politique locale. Mais les chiffres le rappellent : la loi ne crée pas la volonté, elle l’accompagne. La France, comme la Nouvelle-Calédonie, a désormais les outils. Reste à faire en sorte que les femmes ne soient plus seulement élues, mais véritablement aux commandes.