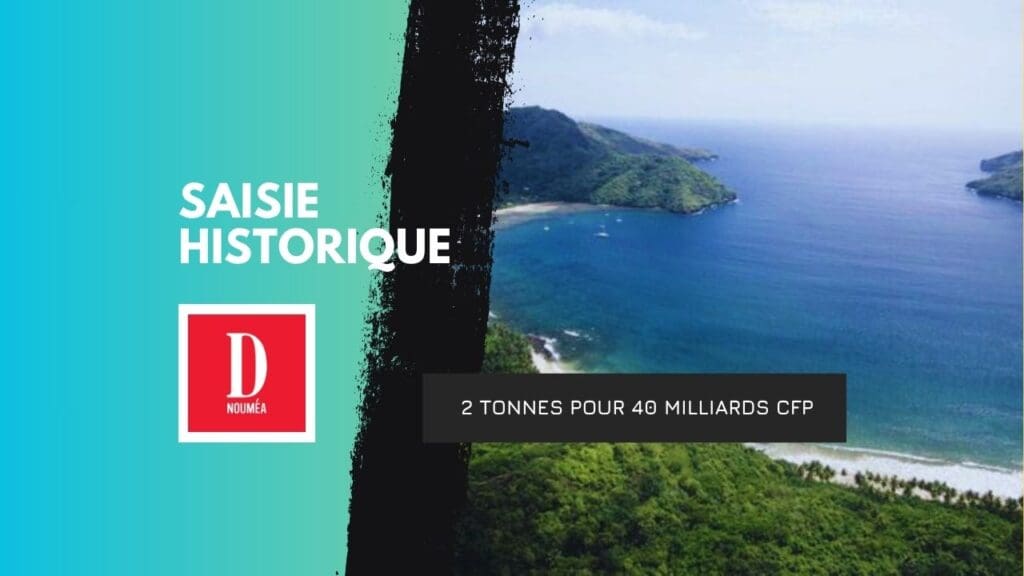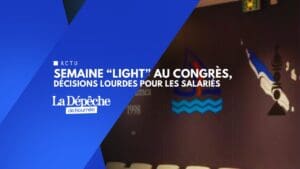La France pollue moins, mais ailleurs. Derrière la baisse des émissions annoncée par l’INSEE, une réalité s’impose : notre empreinte carbone reste massive, portée par des importations toujours plus lourdes.
France 2024 : une baisse en trompe-l’œil
Le 16 octobre 2025, l’INSEE publie son étude annuelle sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). À première vue, la France peut se féliciter : 404 millions de tonnes d’équivalent CO₂ émises en 2024, soit une baisse de 0,9 % par rapport à 2023. L’empreinte carbone totale recule, elle aussi, à 563 millions de tonnes, un recul de 3,4 %.
Mais cette bonne nouvelle cache un déséquilibre préoccupant : la moitié des émissions liées à la consommation française sont désormais produites… à l’étranger. Autrement dit, la France importe sa pollution.
Les ménages français ont émis directement 99 Mt CO₂ d’équivalent CO₂, soit 18 % de l’empreinte nationale. Le reste provient des activités économiques intérieures (180 Mt) et surtout des importations (284 Mt). L’industrie nationale se décarbone lentement, mais les produits qu’elle utilise : électroniques, textiles, véhicules ou énergie fossile, continuent d’être fabriqués dans des pays à fort contenu carbone, comme la Chine ou l’Inde.
Une baisse relative, pas un tournant écologique
Les chiffres le prouvent : la France produit mieux, mais consomme toujours autant. Depuis 1990, les émissions intérieures ont chuté de 31 %, quand l’empreinte carbone n’a baissé que de 20 %. L’écart grandit, reflet d’une désindustrialisation accélérée et d’une dépendance aux importations.
Cette baisse « verte » repose largement sur la performance du parc nucléaire français, redevenu pleinement opérationnel en 2024, et sur la montée en puissance de l’hydraulique et des renouvelables. Les émissions liées à la production d’électricité se sont effondrées de 24,4 %.
Mais d’autres secteurs ruinent ces efforts : le transport maritime international bondit de 11,8 %, dopé par le commerce mondial et le pavillon français. Le transport aérien repart aussi à la hausse (+3,1 %), preuve qu’un mode de vie mondialisé reste incompatible avec la sobriété carbone.
La France propre… sur le papier : souveraineté écologique ou illusion verte ?
Depuis des années, les gouvernements se félicitent de la « décarbonation » du pays. Or, le modèle français repose désormais sur une externalisation massive des émissions. En clair : nous polluons moins ici, mais davantage ailleurs.
En 2024, chaque Français a généré 8,2 tonnes de CO₂ via sa consommation, à peine mieux qu’avant la crise sanitaire. Et surtout, la moitié de cette empreinte provient de produits fabriqués hors de nos frontières, souvent dans des pays où le charbon reste roi.
Ce paradoxe écologique interroge : peut-on prétendre être vertueux en délocalisant sa pollution ? La réalité est que l’économie française, désormais tertiarisée, repose sur une importation continue de biens manufacturés à forte intensité carbone. Smartphones, vêtements, voitures : l’essentiel de ce que nous consommons est produit loin, très loin, des centrales nucléaires de l’Hexagone.
La décarbonation réelle ne pourra passer que par une relocalisation industrielle et un réarmement énergétique souverain. Miser sur la dépendance extérieure tout en se targuant d’être un « bon élève climatique » relève du double discours.
Car si la France a réussi à découpler croissance et émissions internes, elle reste liée au carbone du monde. Nos 563 Mt de CO₂ équivalent en 2024 traduisent autant un progrès qu’un aveu : la transition française se fait au prix du transfert écologique.
Entre sobriété contrainte et écologie importée, la voie reste étroite. Seule une politique assumée, réindustrialiser, produire local, maîtriser l’énergie, permettra d’allier écologie et souveraineté.
Car à force de se verdir sur le papier, la France risque de ne plus rien produire… sauf des bilans carbone flatteurs.