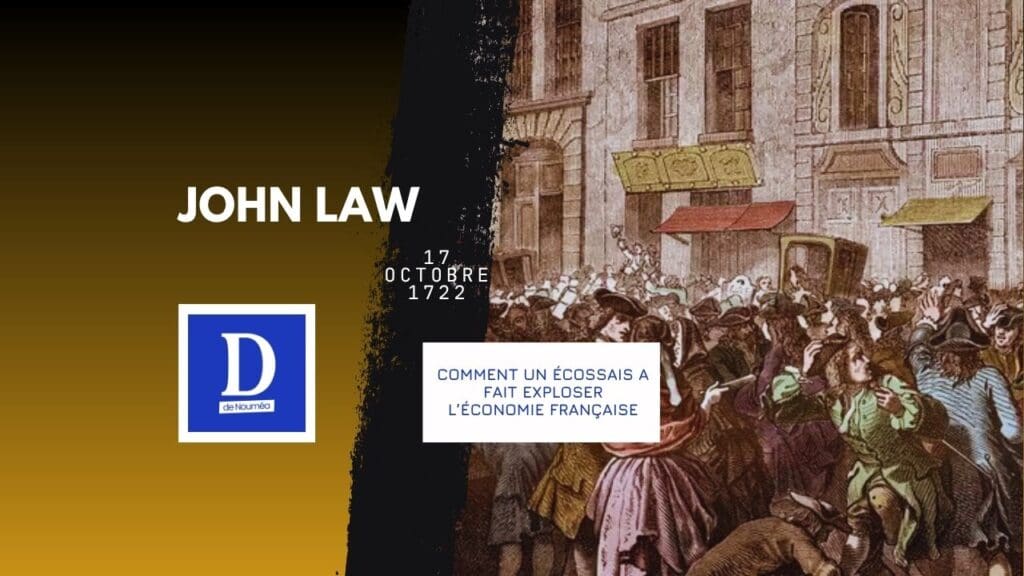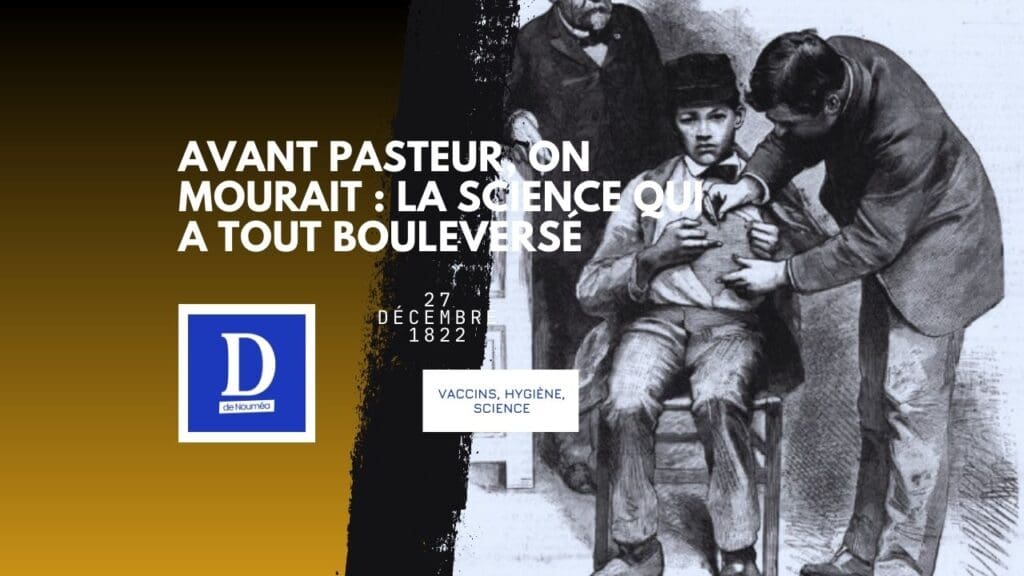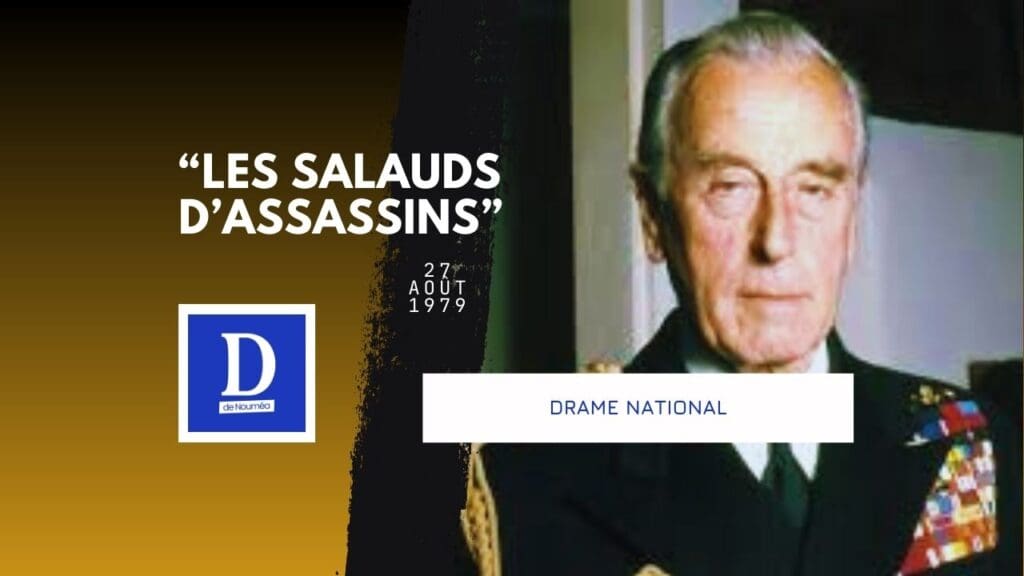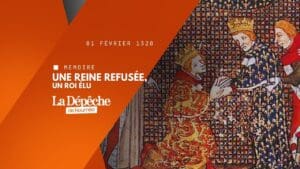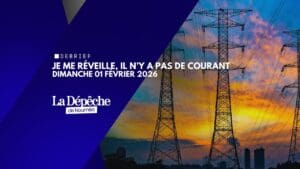Dans une France encore meurtrie par la guerre de Cent Ans, un roi allait bouleverser l’ordre féodal millénaire. En instaurant le premier impôt permanent, Charles VII posait les bases d’un État fort, centralisé, et d’une armée nationale indépendante des féodaux.
Un tournant décisif pour le pouvoir royal et pour la souveraineté française.
Naissance de l’impôt permanent : le jour où la France s’émancipe des seigneurs
2 novembre 1439, Orléans. Charles VII signe une ordonnance historique : désormais, la « taille » sera levée chaque année, sans consultation obligatoire des États généraux. Derrière ce geste administratif se cache une révolution politique. Jusque-là, le roi vivait de ses domaines et devait quémander des aides exceptionnelles pour financer ses guerres.
Mais la guerre de Cent Ans a tout changé. Les campagnes sont dévastées, les vassaux épuisés, les mercenaires ces terribles Écorcheurs ravagent les provinces. Le monarque veut en finir avec ce désordre et affirmer son autorité. Il lui faut une armée permanente, fidèle à la Couronne, financée non plus par la bonne volonté des ordres, mais par une ressource stable : l’impôt royal.
Cette décision marque la fin de la dépendance du roi envers la noblesse guerrière. Le pouvoir féodal cède la place à un embryon d’État moderne, où la légitimité ne se partage plus. Pour la première fois, la France se dote d’un outil fiscal pérenne un pilier de la puissance publique.
Charles VII, le restaurateur de l’autorité nationale
Ce choix audacieux n’est pas qu’une mesure financière : il s’agit d’une affirmation politique. En rompant avec les réflexes médiévaux, Charles VII devient le premier souverain à penser la France comme une nation organisée. Après les victoires de Jeanne d’Arc, il consolide l’unité du royaume, signe la paix d’Arras avec le duc de Bourgogne et prépare la reconquête face aux Anglais.
Mais à quel prix ? En s’arrogeant le droit exclusif de lever la taille, le roi s’attire la colère des seigneurs. Ces derniers voient leur influence diminuer, leur indépendance grignotée. Pourtant, cette centralisation salvatrice était la seule voie pour restaurer l’ordre. Face au chaos des bandes armées, il fallait un État capable d’imposer la loi du roi sur tout le territoire.
Ainsi naît une armée régulière, financée par l’impôt et dirigée par des capitaines nommés par le monarque. Le roi devient le garant de la sécurité nationale, non plus un seigneur parmi d’autres, mais le chef d’une France unifiée.
De l’ordonnance d’Orléans à la Praguerie : les résistances à l’État fort
L’ordonnance du 2 novembre 1439 ne passe pas sans heurts. Les grands féodaux, inquiets de perdre leurs prérogatives, s’unissent dans une rébellion connue sous le nom de Praguerie. Ironie du sort : le chef de cette fronde n’est autre que le dauphin Louis, futur Louis XI, qui contestera plus tard le pouvoir de son propre père avant de l’étendre encore davantage une fois sur le trône.
Ce conflit illustre la transition d’un monde ancien vers un ordre nouveau. Le temps des seigneuries autonomes touche à sa fin : le roi devient l’incarnation de la nation. Avec l’impôt permanent, la France entre dans l’ère moderne, celle d’un État centralisé, fiscalement souverain, militairement organisé.
L’ordonnance d’Orléans fut donc bien plus qu’un texte financier : elle fut l’acte de naissance de la France administrative, de cette puissance publique qui, cinq siècles plus tard, continue de structurer la nation.