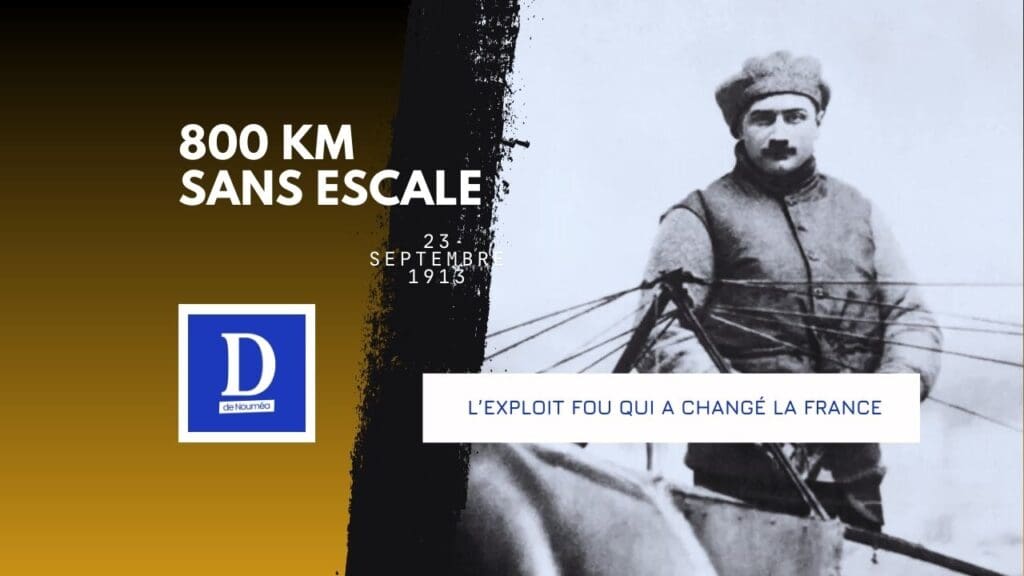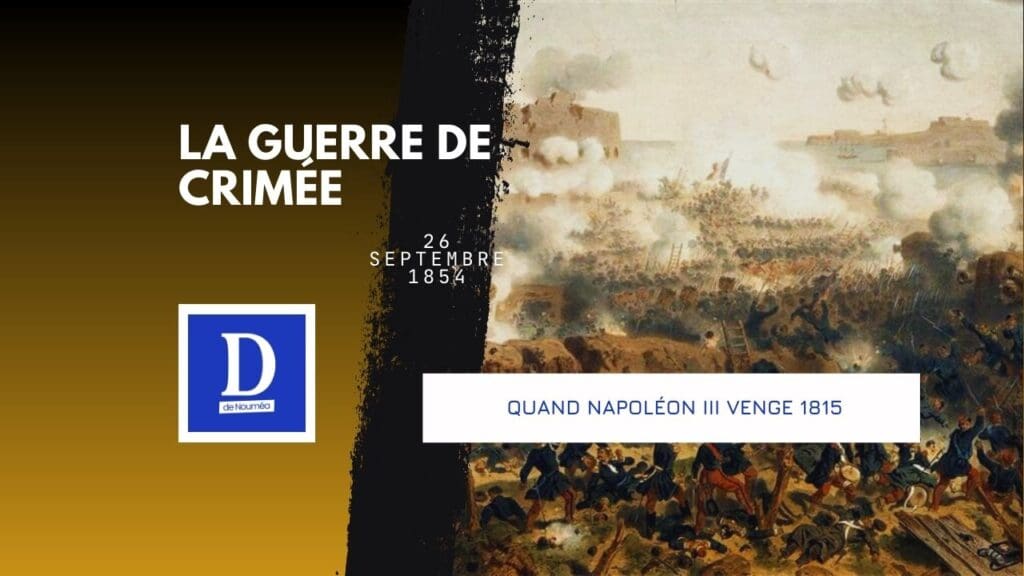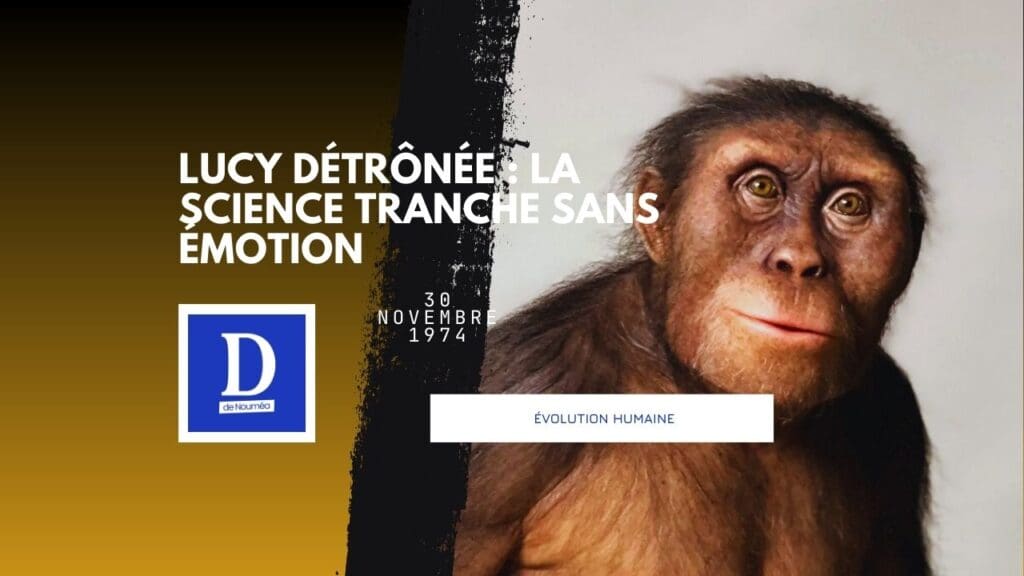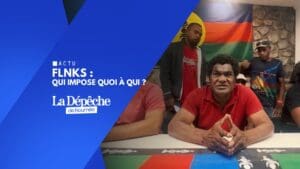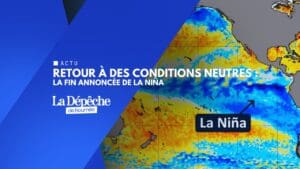Ils ont marché sur la Lune. Mais à quel prix ? Et face à quelles accusations ?
Le 20 juillet 1969, les États-Unis marquent l’Histoire. Mais derrière ce « petit pas » se cache une guerre invisible et une prouesse contestée…
La Lune, théâtre d’un exploit historique et d’une guerre froide silencieuse
Le 20 juillet 1969, à 20h17 UTC, la voix de Neil Armstrong résonne dans les écouteurs des opérateurs de la NASA : « Houston, ici la base de la Tranquillité. L’Aigle a atterri. » L’Amérique vient de prendre sa revanche sur Spoutnik, Gagarine, et sur tous les revers de la décennie écoulée. L’alunissage d’Apollo 11, fruit de 400 000 ingénieurs et 25 milliards de dollars, offre aux États-Unis bien plus qu’un exploit scientifique : une victoire géopolitique écrasante contre l’URSS.
La mission Apollo XI est le couronnement du pari lancé par John F. Kennedy en 1961 : envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Face à l’humiliation de la baie des Cochons et à la supériorité soviétique dans la conquête spatiale, le président démocrate décide de faire de l’espace un terrain de reconquête symbolique. La NASA, fondée à peine une décennie plus tôt, s’attaque à l’impossible. Le résultat : le plus grand exploit technologique de l’humanité.
Pourtant, derrière les images triomphales de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, peu de gens connaissent les expériences scientifiques, les relevés sismiques, les collectes de roche lunaire et même le déploiement d’un réflecteur laser encore actif aujourd’hui. Pendant 2 heures et 31 minutes, deux hommes explorent la Mer de la Tranquillité, pendant qu’un troisième, Michael Collins, tourne seul autour de la Lune dans le module de commande.
Une mise en scène hollywoodienne ? Quand les complots s’en mêlent
Ce premier pas sur la Lune a été suivi par près de 500 millions de téléspectateurs. Pourtant, cinquante ans plus tard, les théories du complot pullulent. Certaines sont devenues virales, portées par le doute, l’ignorance ou la méfiance envers les institutions.
Première accusation : les images ont été tournées en studio, dans un décor hollywoodien. Le réalisateur Stanley Kubrick est même accusé d’avoir monté l’opération pour le compte de la CIA, dans le sillage de son film 2001, l’Odyssée de l’espace. Aucune preuve, aucun témoin, aucun élément sérieux ne vient corroborer cette rumeur. Les images “de studio” proviennent en fait de séances d’entraînement à Houston, bien identifiées par la NASA.
Deuxième preuve avancée : le drapeau américain flotte dans le vide. Or, la Lune étant dépourvue d’atmosphère, cela serait “impossible”. Ce que les sceptiques ignorent, c’est que le drapeau était muni d’une tige horizontale rigide, justement pour le maintenir visible. Les plis visibles sont dus au rangement dans le module.
Troisième obsession : l’absence d’étoiles dans les photos lunaires. Là encore, la science répond clairement : la forte luminosité du sol lunaire empêche les capteurs de capter les étoiles, tout comme les smartphones surexposés aujourd’hui.
Ajoutons à cela une empreinte de botte mal interprétée, une soi-disant roche marquée d’un « C » (en réalité un cheveu sur un cliché développé), et la peur des radiations dans la ceinture de Van Allen, souvent exagérée. Tous ces éléments ont été invalidés par les scientifiques, les ingénieurs et les documents originaux.
Science-fiction devenue réalité : la trace indélébile d’Apollo 11
Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V décolle de Cap Canaveral. Haute de 110 mètres, elle propulse trois hommes dans l’espace. Quatre jours plus tard, le module lunaire Eagle se détache du vaisseau principal pour descendre sur la Lune. Ce moment, diffusé en direct, devient une icône : un homme quitte son monde pour en fouler un autre.
« Un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité », déclare Neil Armstrong à 3h56 du matin (UTC). En quelques mots, il cristallise des siècles de rêves, de fantasmes et de conquêtes. De Jules Verne à Georges Méliès, de Tintin à Star Trek, la Lune a toujours été le symbole d’un au-delà accessible. Apollo 11 le prouve : ce que l’on rêve, on peut le faire.
Cette marche, pourtant, ne dura qu’un instant. Les astronautes ne passeront que 21 heures sur la Lune, dont 2h30 à l’extérieur. Puis, ils regagneront la Terre, avec des échantillons, des données, et une histoire inscrite à jamais dans l’imaginaire collectif.
Depuis, douze hommes y ont marché sur la Lune. Aucun depuis 1972. Le programme Artemis porté par la NASA, avec la collaboration d’autres agences spatiales, vise un retour habité sur la Lune avant 2030. L’histoire n’est donc pas finie. Mais rien ne pourra égaler la première fois.