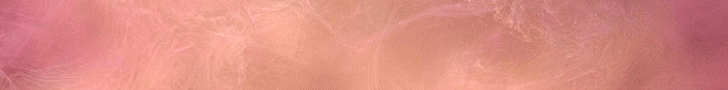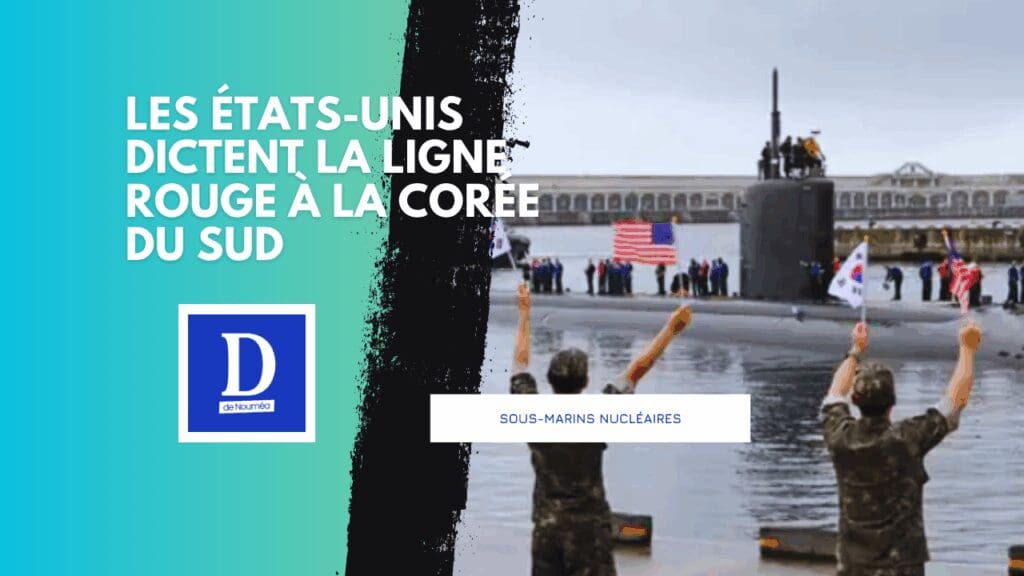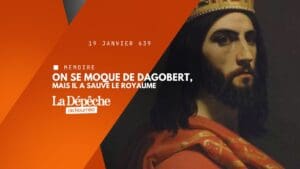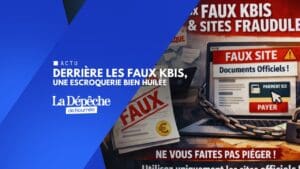500 000 amendes pénales sans procès ont été infligées en 2024. En pleine expansion, la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) vise désormais 85 délits. Si elle soulage les tribunaux, elle inquiète les défenseurs des droits.
Un dispositif étendu… et massivement utilisé
Le recours aux AFD a littéralement explosé. En 2019, 57 300 amendes avaient été émises, soit neuf fois moins qu’en 2024. L’usage de ce levier juridique s’est surtout intensifié depuis que les forces de l’ordre peuvent l’utiliser pour une multitude d’actes délictueux. 77 % des défauts d’assurance, 76 % des usages de stupéfiants et 95 % des occupations d’immeubles ont été sanctionnés par AFD en 2024.
Le volume global de ces procédures représente désormais 10 % de l’ensemble des délits constatés dans le pays, une proportion qui n’était que de 1 % il y a cinq ans. Si certains délits sont peu concernés (vols simples, installations sur terrain privé), d’autres, comme les infractions routières, sont quasi systématiquement traités via AFD.
Les trois délits les plus visés en 2024 sont :
– défaut d’assurance (41 %),
– usage de stupéfiants (39 %),
– défaut de permis de conduire (9 %).
Une tendance confirmée dans la majorité des départements, même si des écarts territoriaux existent.
Des territoires surverbalisés et des profils exclus
Certaines zones concentrent un usage massif de cette procédure. À Paris, dans les Yvelines, à Mayotte ou en Guyane, plus de 80 % des défauts d’assurance sont désormais traités par AFD. Cette généralisation s’accompagne aussi d’une augmentation du nombre de délits constatés : +28 % par an dans ces départements, contre +17 % ailleurs.
Mais cette explosion des AFD modifie aussi le profil des personnes poursuivies. En étant réservée aux majeurs, non récidivistes et domiciliés, cette procédure exclut d’office les mineurs, les sans-domicile et les multirécidivistes.
Résultat : la part des mineurs chute fortement. Pour usage de stupéfiants, ils représentaient 17 % des mis en cause entre 2016 et 2018, contre 4 % seulement en 2024. Même constat pour les vols à l’étalage : de 24 % à 5 %.
Par ailleurs, le profil type des personnes sanctionnées évolue. Les personnes étrangères sont moins souvent mises en cause, tandis que la part des femmes augmente – sauf pour les délits liés à la drogue ou aux occupations d’immeubles.
Une simplification judiciaire sous tension
Derrière l’essor de cette procédure, le ministère de l’Intérieur entend poursuivre sa politique de rationalisation judiciaire, en allégeant le rôle des magistrats. Une logique efficacité-chiffre, dénoncée par plusieurs associations de défense des droits. Le caractère automatisé des sanctions, les délais courts et les voies de recours complexes renforcent la sensation d’une justice à deux vitesses.
Si le gouvernement vise à généraliser ce modèle à plus de 3 000 délits passibles d’un an d’emprisonnement, les oppositions montent au sein même de la magistrature. Pour certains avocats pénalistes, « la procédure AFD transforme le droit pénal en guichet administratif ».
Face à un tel basculement, la question reste entière : la répression immédiate vaut-elle l’abandon du débat judiciaire ? Alors que près d’un demi-million de citoyens ont déjà été concernés en 2024, la réponse semble désormais plus politique que juridique.