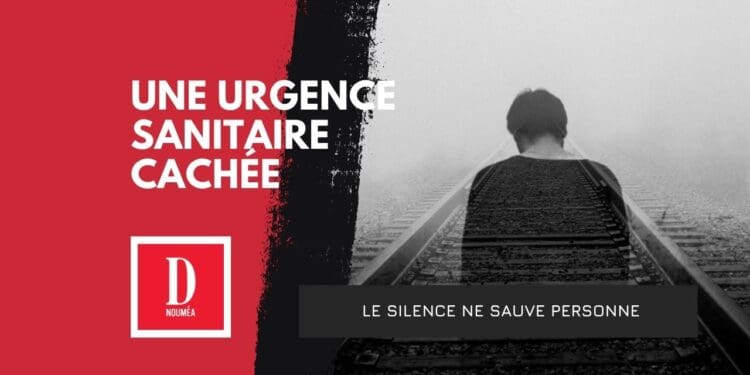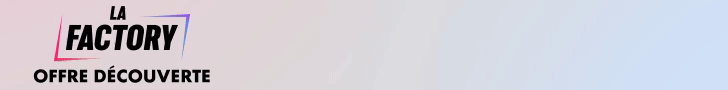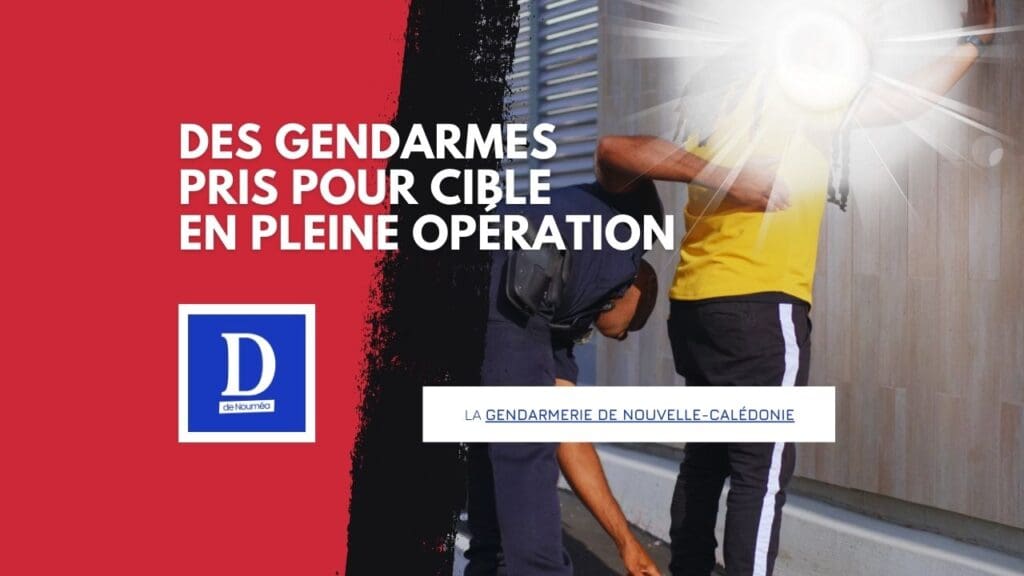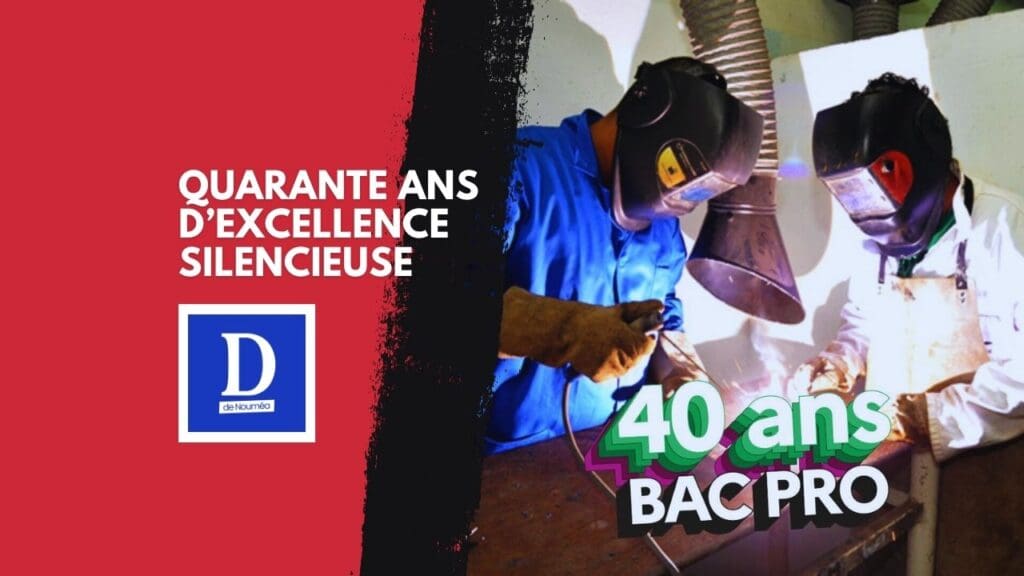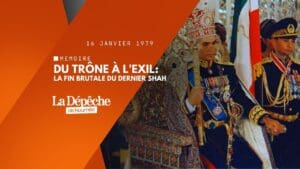Un adolescent de 16 ans a sauté du pont des Érudits à Dumbéa ce mercredi. Il est mort quelques heures plus tard au Médipôle. Ce drame, en pleine journée, a choqué les automobilistes et relancé un débat resté trop discret : celui de la santé mentale des jeunes en Nouvelle-Calédonie.
Un fléau qui frappe plus fort qu’en métropole
Le taux de suicide atteint 15 pour 100 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, soit bien au-dessus de la moyenne nationale française. Chaque année, près de quarante personnes mettent fin à leurs jours, avec une surreprésentation chez les hommes de 25 à 44 ans et chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans.
Le suicide est ainsi la deuxième cause de mortalité chez les jeunes Calédoniens, juste derrière les accidents de la route. Ce phénomène, particulièrement alarmant dans les territoires insulaires du Pacifique, semble lié à des mutations sociales brutales. Ruptures culturelles, isolement, précarité, violences familiales, addictions : les causes sont multiples et souvent entremêlées. Comme tea, jeune lycéen de 16 ans :
J’ai commencé à me sentir vide au collège. Je n’arrivais plus à dormir, je pleurais tout le temps sans savoir pourquoi. À la maison, on ne parle pas de ce genre de choses. Mon père me disait de me ressaisir, que j’exagérais.
J’ai subi des moqueries au lycée, j’ai perdu une amie. Et puis j’ai commencé à penser que ça serait peut-être plus simple si je n’étais plus là.Un jour, j’ai tapé « comment se suicider sans souffrir » sur mon téléphone. Je l’ai refermé, mais c’est resté dans ma tête pendant des semaines. Je me suis dit que si je disparaissais, ça n’aurait pas d’importance.
Ce qui m’a retenue ? Une prof. Elle a vu que je m’isolais. Elle m’a parlé sans me juger. Elle m’a orientée vers une psy scolaire. Et petit à petit, j’ai compris que j’avais le droit d’aller mal, mais surtout que je pouvais aller mieux.
Aujourd’hui, j’ai encore des hauts et des bas, mais je parle. J’ai repris le sport, je vois mes copines. Je veux dire aux autres : on n’est pas seuls, même si on a l’impression de l’être. Il faut oser demander de l’aide.
Les jeunes filles en première ligne, mais les garçons meurent plus
Selon le Baromètre Santé Jeune de 2019, près de 16 % des 10-18 ans ont pensé au suicide dans l’année, et un sur dix a tenté de passer à l’acte. Les filles déclarent deux fois plus de tentatives que les garçons, mais ces derniers utilisent des méthodes plus létales : la pendaison et les armes à feu.
La communauté kanak est particulièrement vulnérable. Les jeunes vivant en tribu ou issus des populations océaniennes sont plus nombreux à signaler des pensées suicidaires, en lien avec des facteurs comme les violences subies, le mal-être familial, l’usage de cannabis ou d’alcool, et un sentiment d’insécurité à l’école.
L’étude souligne un contraste territorial frappant : les jeunes des îles Loyauté, où le cadre coutumier reste fort, sont moins exposés au risque suicidaire que ceux de la province Sud.
Vers une stratégie locale de prévention, ancrée culturellement
La prévention reste faible et peu structurée. Pourtant, des recommandations existent : restreindre l’accès aux armes à feu, lutter contre les violences intrafamiliales, former les enseignants et les travailleurs sociaux à détecter les signaux d’alerte, et renforcer les aides psychologiques accessibles.
Des associations comme Airain et Hippocampe œuvrent déjà sur le terrain. Une plateforme d’écoute téléphonique (05 30 30) est ouverte jusqu’à 1 h du matin. Mais les tabous restent tenaces. « Aller voir un psy, c’est encore perçu comme honteux. Il faut casser ce mythe », plaide une thérapeute du Médipôle.
Le phénomène touche des jeunes dès l’âge de 10 ans. Et il ne faiblit pas : le taux de tentatives a augmenté de 40 % entre 2014 et 2019. Face à cela, les professionnels réclament la création d’un observatoire local du suicide, pour produire des données fiables et guider les politiques publiques.
Selon les experts, la promotion de la santé mentale passe par l’éducation émotionnelle, le soutien parental, la prévention des violences, et une prise en charge des addictions dès le collège. La jeunesse calédonienne a besoin d’un accompagnement adapté à ses réalités sociales et culturelles.
Le suicide des jeunes en Nouvelle-Calédonie n’est pas une fatalité. C’est une crise sanitaire évitable, à condition d’y consacrer des moyens, de la volonté politique, et une approche respectueuse des spécificités culturelles du territoire. Le silence ne sauve personne.