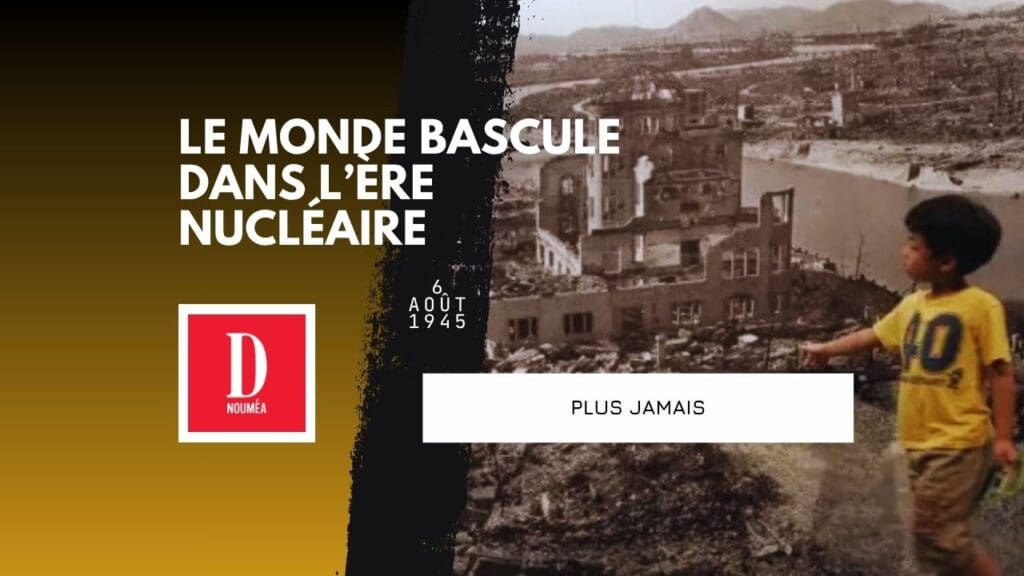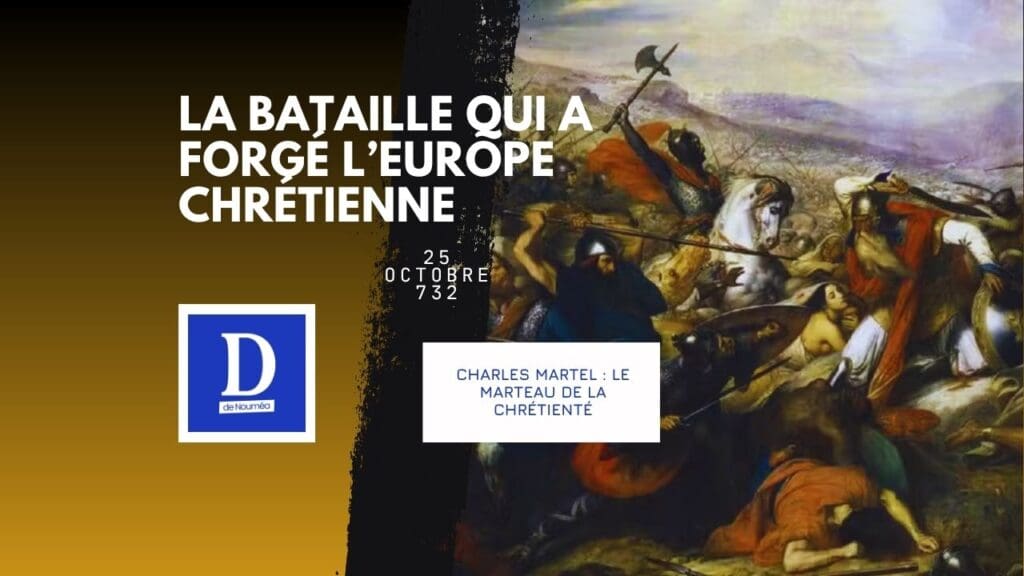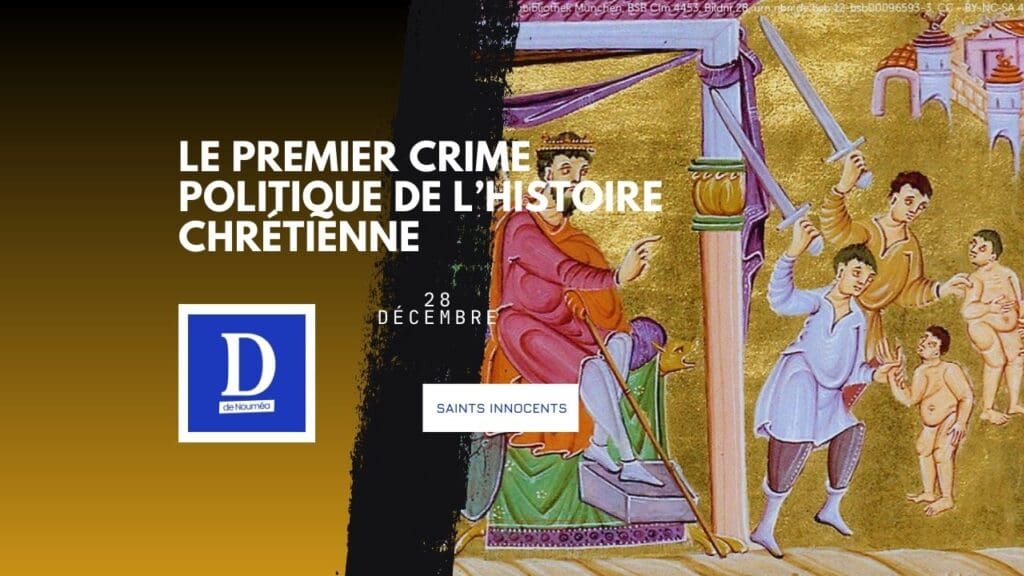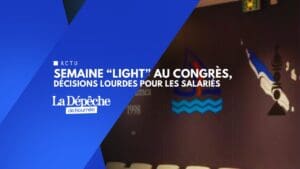Des siècles après Jeanne d’Arc, une autre femme aura incarné, à sa manière, la foi, le courage et la France du cœur. Sœur Emmanuelle, la « chiffonnière du Caire », s’est éteinte il y a dix-sept ans, à l’âge de 99 ans. Mais son message : celui du travail, de la dignité et de la foi, résonne encore.
Sœur Emmanuelle : la rebelle de Dieu
Née Madeleine Cinquin en 1908 à Bruxelles, fille d’un père français et d’une mère belge, Sœur Emmanuelle n’était pas prédestinée à la misère du monde. Issue d’une bourgeoisie prospère, elle grandit dans le confort jusqu’à ce drame fondateur : la mort de son père, sous ses yeux, à l’âge de six ans. C’est ce jour-là, confiera-t-elle plus tard, que sa vocation religieuse est née.
Elle entre en 1929 dans la congrégation de Notre-Dame de Sion, prononce ses vœux en 1931 et choisit le nom d’Emmanuelle, « Dieu avec nous ». Docteure en philosophie et en théologie, elle enseigne dans plusieurs pays du monde musulman, Turquie, Tunisie, Égypte, avant de prendre une décision radicale : quitter les écoles huppées pour les bidonvilles du Caire. Là, au milieu des chiffonniers, des ordures et des enfants sans avenir, elle vivra plus de vingt ans.
Son cri de ralliement ? « Yalla ! En avant ! » Une exhortation simple, arabe, joyeuse, qui résume à elle seule sa foi dans l’action et le dépassement de soi. Sœur Emmanuelle ne prêchait pas la plainte, mais la responsabilité. Elle incarnait une charité enracinée dans la dignité, non dans la victimisation.
Asmae : la charité organisée, pas la compassion naïve
En 1985, elle fonde Asmae – Association Sœur Emmanuelle, ONG toujours active aujourd’hui dans huit pays, de l’Égypte au Burkina Faso, en passant par la France. Son principe ? L’aide sans assistanat.
Trois règles immuables guidaient son œuvre :
-
Agir avec pragmatisme, au contact du terrain ;
-
S’appuyer sur des partenaires locaux plutôt que sur une bureaucratie lointaine ;
-
Chercher l’autonomie des bénéficiaires, non leur dépendance.
C’était là toute la différence entre la charité chrétienne et l’aide compassionnelle mondaine. Sœur Emmanuelle croyait au relèvement par le travail, à l’éducation comme levier de liberté. En 2022 encore, Asmae soutenait près de 40 000 enfants dans le monde. Preuve qu’un idéal enraciné peut survivre à son incarnation.
Elle disait souvent :
Ce n’est pas l’argent qu’il faut donner, mais la main. Une phrase qui résume à la fois sa lucidité et sa tendresse.
Là où d’autres prêchaient la repentance ou la révolte, elle incarnait le pardon actif et la responsabilité partagée.
Une femme libre, une foi française
Populaire, médiatique, elle ne se travestissait jamais pour plaire. En baskets, en blouse grise, visage malicieux et verbe franc, elle imposait un style.
En 2002, Jacques Chirac la décore de la Légion d’honneur, saluant son courage et son humanité. Elle ne s’en émeut guère : son royaume n’est pas de ce monde, mais son œuvre, oui. Elle continuera jusqu’à l’âge de 85 ans, avant d’être rappelée en France par sa hiérarchie, un exil qu’elle vécut comme une épreuve.
Installée dans le Var, elle consacre ses dernières années à la prière et au soutien des sans-abris. Jusqu’à son dernier souffle, elle refusera le cynisme moderne, préférant la foi dans l’homme et le travail à la complainte permanente.
Le 20 octobre 2008, à la veille de ses 100 ans, Sœur Emmanuelle s’éteint. Non dans l’indifférence, mais dans la gratitude d’un peuple qui voyait en elle une France lumineuse, spirituelle, courageuse. Quinze ans après, son « Yalla ! » résonne encore comme un appel : celui de la charité joyeuse et du devoir d’agir.