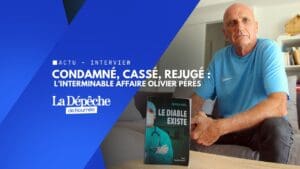Le constat est brutal : la France néglige des territoires ultramarins, pourtant riches de ressources et d’ambitions. Dans un rapport publié le 20 octobre 2025, la Cour des comptes dresse un diagnostic sans appel : le tourisme, pilier économique des outre-mer, reste mal exploité, mal mesuré et mal accompagné.
De la Guadeloupe à la Polynésie française, en passant par la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie, le tourisme représente entre 5 % et 17 % du PIB, un gisement d’emplois et de fierté nationale. Mais faute de stratégie claire, la France laisse s’étioler l’un de ses atouts les plus puissants dans le monde.
Des territoires riches, une ambition absente
Le rapport rappelle qu’avant la crise sanitaire, le tourisme ultramarin attirait 2,7 millions de visiteurs et générait plus de 2,5 milliards d’euros (environ 298 milliards de francs CFP) de recettes annuelles. Pourtant, aucune vision d’ensemble n’a été consolidée. Chaque collectivité agit isolément, dans un flou statistique total : les données sur l’emploi touristique datent parfois de six ans et varient d’un organisme à l’autre.
Résultat : les collectivités ne savent plus où concentrer leurs efforts, ni comment former les jeunes. Et dans des territoires où le chômage dépasse encore les 25 %, les employeurs du tourisme peinent à recruter. Un paradoxe !
Car les jeunes partent, faute de perspectives. Les métiers de l’hôtellerie, de la restauration ou de l’accueil souffrent d’une image dégradée, de salaires faibles et de conditions précaires. « Le tourisme ne fait plus rêver », résume un chef d’entreprise de Fort-de-France, cité par la Cour.
Ce constat fait écho à une tendance nationale : la France parle beaucoup d’attractivité, mais oublie de valoriser ceux qui la font vivre. Dans les outre-mer, le patriotisme économique devrait pourtant s’incarner dans ce secteur clé.
La Cour des comptes dénonce l’échec de la stratégie de l’État
Selon le rapport, la politique de l’emploi et de la formation professionnelle est totalement inadaptée. Les aides sont dispersées, les crédits éclatés entre plusieurs ministères, sans aucun ciblage spécifique sur le tourisme. La direction générale des outre-mer, l’Insee et Atout France travaillent chacun dans leur couloir, sans coordination réelle.
Pire encore, les chiffres sur les emplois touristiques ne sont même pas consolidés au niveau national. Autrement dit : l’État ne sait pas combien d’emplois dépendent réellement du tourisme ultramarin.
La Cour recommande donc trois mesures fortes :
-
Mettre à disposition des collectivités ultramarines une méthodologie statistique homogène avant fin 2026.
-
Mesurer enfin la part réelle des dépenses publiques allouées au secteur touristique.
-
Créer dans chaque territoire un contrat d’objectifs Emploi-Formation spécifique au tourisme.
Des propositions de bon sens, mais qui soulignent surtout le vide politique : depuis le plan « Destination France » de 2021, aucune réforme sérieuse n’a été appliquée.
Le rapport met aussi en lumière la dépendance excessive au modèle balnéaire, hérité des années 1970. Les plages ne suffisent plus à faire venir les visiteurs ; la concurrence de la République dominicaine, de Maurice ou de Cuba est devenue féroce.
Et pourtant, les atouts français sont immenses : 80 % de la biodiversité nationale et 97 % de l’espace maritime français se trouvent outre-mer. Ces territoires sont le visage du rayonnement français dans le monde, mais Paris continue de les traiter comme des marges administratives.
Vers un tourisme durable : promesse verte ou mirage institutionnel ?
La Cour insiste : le salut du tourisme ultramarin passera par sa mutation écologique. Un « tourisme durable » capable de conjuguer développement économique et préservation des ressources.
Les initiatives existent : en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie ou à la Réunion, l’éco-tourisme progresse. Mais elles restent trop isolées et mal financées. Les formations à ces nouveaux métiers, guides naturalistes, gestionnaires d’espaces protégés, maintenance d’énergies vertes, manquent de moyens.
Les plans d’investissement dans les compétences (PRIC) auraient dû résoudre le problème. Ils n’ont produit aucun effet mesurable sur l’emploi touristique. Les dispositifs nationaux, pensés pour l’Hexagone, ne tiennent pas compte des réalités locales : coût de la vie, éloignement, insularité.
La Cour des comptes appelle à une révolution pragmatique : articuler emploi, tourisme et développement durable dans une stratégie cohérente, assortie d’objectifs chiffrés et de résultats évaluables. Autrement dit : faire enfin de ces territoires des laboratoires du tourisme français, et non des vitrines exotiques oubliées.
Le rapport de la Cour des comptes n’accuse pas seulement l’administration : il met face à leurs contradictions les décideurs métropolitains. Pendant que les voisins caribéens ou mauriciens misent sur la formation, la qualité et la stabilité, la France persiste à bricoler son modèle touristique ultramarin, oscillant entre bonne conscience écologique et inertie bureaucratique.
Redonner aux outre-mer la place qu’ils méritent, c’est aussi redonner à la France son ambition mondiale. Parce que le tourisme, c’est du travail, de la fierté et du rayonnement. Et dans ces territoires qui incarnent la beauté française, l’emploi touristique n’est pas une variable d’ajustement : c’est une promesse d’avenir.