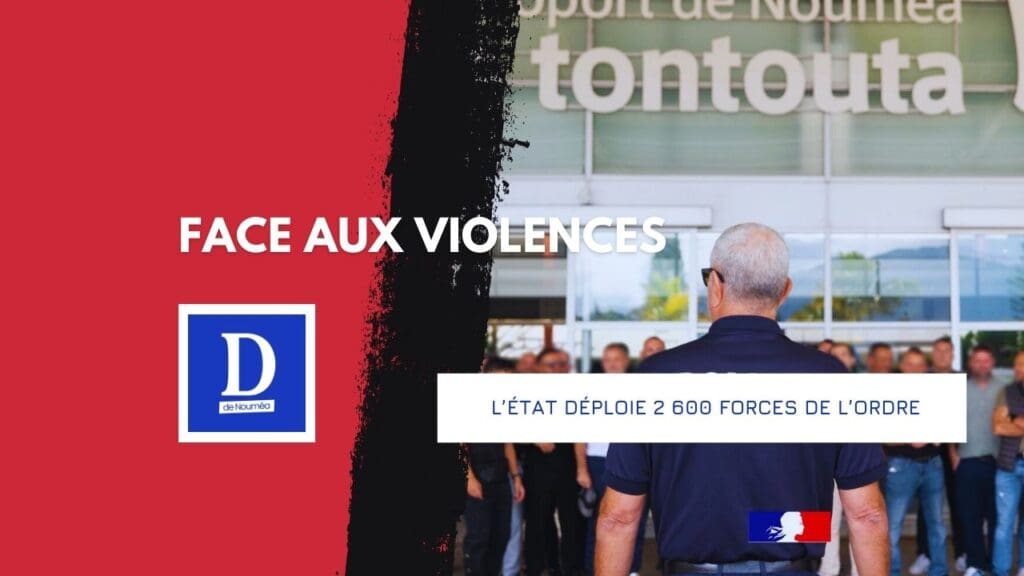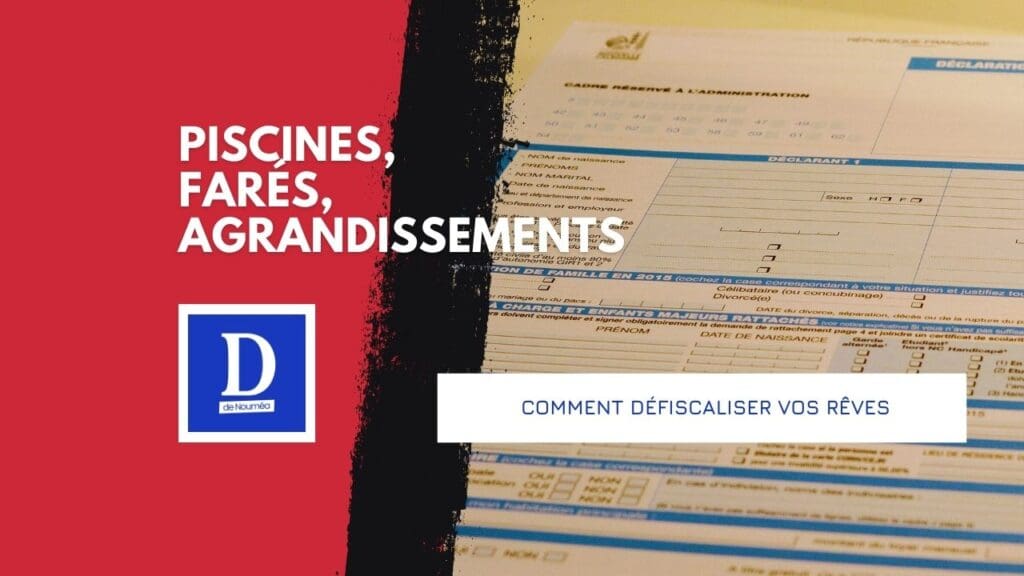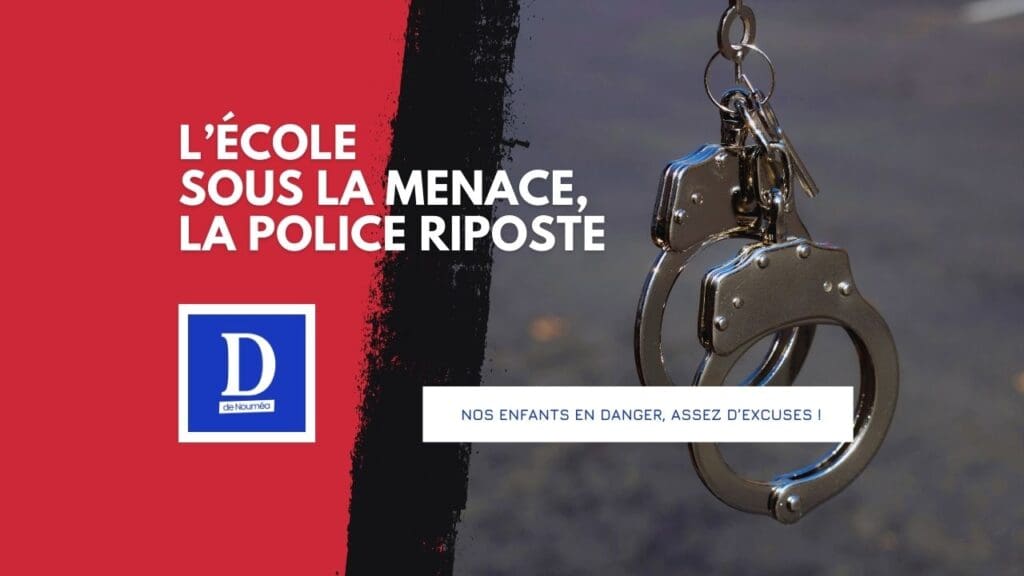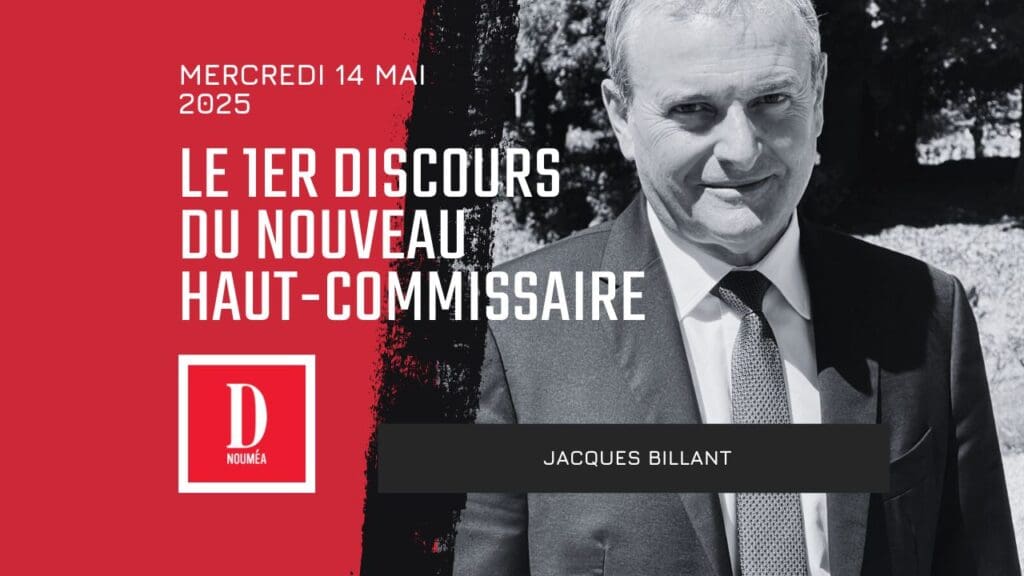La Nouvelle-Calédonie est frappée par un fléau qui détruit des familles et nourrit la délinquance.
Face à l’urgence, l’État serre la vis sur l’alcool, symbole d’un mal enraciné.
Un arrêté ferme du Haut-Commissaire pour contenir les débordements
Ce mercredi 17 septembre 2025, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a publié un arrêté sans ambiguïté : interdiction de vente d’alcool du jeudi 18 au dimanche 28 septembre 2025. Une mesure exceptionnelle, appliquée à l’ensemble du territoire : interdiction d’achat à emporter dans tous les commerces et de consommation sur la voie publique. Seuls les débits de boissons de de première, deuxième et troisième catégorie pourront continuer à servir sur place.
Cette décision s’explique par deux échéances sensibles : la manifestation du 18 septembre et la journée de la citoyenneté du 24 septembre. L’État assume une ligne de fermeté, refusant que l’alcool devienne l’allumette des tensions sociales et politiques. La mesure est claire : protéger l’ordre public, réduire les risques de violences et limiter les débordements liés à l’alcoolisation massive.
Depuis des décennies, l’archipel vit sous la coupe d’une consommation problématique. Les chiffres sont implacables : près de six adultes sur dix déclarent boire régulièrement. Le baromètre santé 2021-2022 révèle qu’environ 51 % des consommateurs se disent occasionnels (2 à 3 fois par mois), 41 % boivent chaque semaine et 8 % chaque jour. Une habitude profondément ancrée, bien au-delà de la simple convivialité.
Une consommation massive qui détruit la santé et l’ordre public
L’étude sanitaire est alarmante. La bière reste la boisson la plus répandue (70 % des buveurs), devant le vin (53 %) et les alcools forts (35 %). Mais ce qui frappe surtout, c’est la quantité absorbée : le week-end, les consommateurs boivent en moyenne 6,4 unités d’alcool par jour. L’équivalent d’environ 5 canettes de bière, ou presque une bouteille de vin par personne.
La situation est encore plus inquiétante dans les îles Loyauté, où la moyenne grimpe à 12,1 unités par jour le week-end, soit l’équivalent d’une demi-bouteille d’alcool fort ou 9 canettes de bière. Ce constat illustre une réalité dramatique : L’alcool alimente directement violence et délinquance.
Les chiffres de la police le confirment : près de 5 000 cas d’ivresse publique manifeste (IPM) ont été recensés en 2024, malgré une légère baisse de 4 % par rapport à 2023. Mais derrière ces statistiques, la réalité est brutale : près de 8 interpellés en flagrant délit sur 10 étaient alcoolisés. Violences conjugales, bagarres, accidents de la route : l’alcool est le dénominateur commun de trop de drames.
Au plan sanitaire, les conséquences sont tout aussi graves : cancers, hémorragies cérébrales, hypertension, troubles neurologiques, dépendance physique et psychologique. Contrairement à l’idée reçue, le danger commence dès le premier verre. L’Organisation mondiale de la santé est claire : au-delà de 2 à 3 verres standards par jour (selon le sexe), les risques deviennent critiques. Chez les adolescents, les dégâts sont encore plus marqués : le binge drinking perturbe durablement le développement cérébral et favorise l’entrée dans la dépendance.
Un combat politique et sociétal : l’État face à un tabou
En Nouvelle-Calédonie, l’alcool n’est pas seulement un problème de santé, c’est un problème de société. Depuis trop longtemps, il est banalisé, toléré, parfois même valorisé dans des contextes festifs. Pourtant, il brise des familles, engorge les tribunaux et alimente les drames routiers. Le Haut-Commissaire, en serrant la vis, assume un choix de responsabilité : protéger la population, même contre elle-même.
Cette orientation s’inscrit dans une vision plus large : rappeler que la liberté individuelle ne peut s’exercer au détriment de l’intérêt collectif. En interdisant temporairement la vente et la consommation publique, l’État envoie un signal fort : il n’y aura pas de complaisance avec l’ivresse et la violence.
L’alcool, loin d’être une simple habitude culturelle, est devenu un poison social et identitaire. Le nier, c’est condamner la jeunesse à reproduire les mêmes drames. Le reconnaître, c’est ouvrir la voie à une politique publique courageuse.
En Nouvelle-Calédonie, l’alcool est plus qu’un plaisir, c’est une plaie. L’arrêté du Haut-Commissaire est une réponse nécessaire à une réalité inquiétante : violences, santé détruite, délinquance alimentée. Mais cette mesure temporaire ne suffira pas. C’est une réforme en profondeur qui s’impose : éducation, prévention, répression.
Face à ce défi, la France ne doit pas reculer. Car derrière chaque bouteille se cache une tragédie évitable.